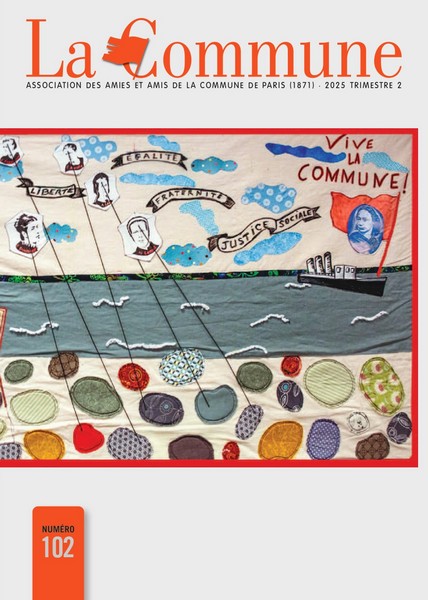L'ultime barricade de la Commune était-elle située dans le XIe, le XIXe ou XXe arrondissement de Paris ? C'est l'une des questions que I'historien peut se poser. Mais il y en a bien d'autres que celle ci : sait-on réellement qui étaient ses défenseurs ? Les réponses que l'on peut trouver, au delà des patriotismes administratifs, construisent un mythe dont l'enjeu est la transformation d'une réalité autant sociale que politique pour « la bonne cause »

Le lieu et l’heure
Nous savons tous qu'en mai 1871, après deux mois de pouvoir révolutionnaire parisien, l'armée et la police du Gouvernement de Versailles sont rentrés dans Paris par les quartiers bourgeois de l’ouest avant de progresser jour après jour jusque dans les quartiers ouvriers de l'est où les partisans de la Commune étaient plus nombreux. Cette période de combats et de massacres, du 21 au 28 mai, est restée dans l’histoire sous le nom de « semaine sanglante ».
On se réfère généralement à l’historien communard Lissagaray qui signale que, le 28 mai. « À une heure, tout était fini », « les ultimes combats ont eu lieu rue Ramponneau », donc dans le bas du XXe arrondissement. Il s’agit de sa grande Histoire de la Commune de 1871, parue en 1876 et augmentée en 1896. En effet, dans son livre de 1871, publié a Bruxelles, Les huit journées de mai derrière les barricades, il note que la lutte fut circonscrite au nord de la Folie Méricourt et au sud de Belleville, mais il n’évoque pas une dernière barricade — donc ne parle pas de celle de la rue Ramponneau — et ne précise pas d’heure pour la fin du combat. Ceci nous permet en tout cas d’écarter l’hypothèse selon laquelle il aurait été le dernier combattant, rue Ramponneau, décrit par lui même dans son Histoire de la Commune de 1871. Au niveau du lieu, on laissera bien sûr de côté le nom de la rue Rambutau, sise au centre de la capitale, et que l’on a confondu avec la rue Ramponneau. Il en est de même pour un certain nombre de sites signalés comme ayant servi de dernier champs de bataille comme la rue Oberkampf, la rue Haxo ou le Père Lachaise. Il faudrait par ailleurs pouvoir débattre pièces en main de ce qu’ont écrit certains auteurs comme Jean Braire qui dans son livre, Sur les traces des communards, indique que « la dernière barricade se situe à l’angle de la rue Jean-Pierre Timbaud et de la rue Saint-Maur ». J. Braire, qui a fourni un beau travail de recherche, semble en effet avoir trouvé des renseignements originaux : le dernier coup de canon aurait été tiré là à 4 h du soir et il ajoute « jusqu’à la nuit on se battra encore sur les barricades du 11e et du 20e ». Notons ici que Sarrepont, officier supérieur de l’armée de Versailles, avait estimé, dans sa Guerre des communeux de Paris 18 mars 28 mai 1871, que l'insurrection avait été étouffée à « quatre heures », une heure que proposait déjà Georges Jeanneret dès 1871 dans son Paris pendant la Commune révolutionnaire de 1871. Robert Tombs, dans La guerre contre Paris 1871, une publication de 1997, nous propose un nouveau lieu et une autre heure, en s’appuyant sur le journal de marche du 50e bataillon de chasseurs et une biographie du nationaliste Paul Déroulède. Cette « dernière escarmouche », au cours de laquelle Déroulède fut gravement blessé a un bras, aurait eu pour théâtre « une barricade occupée rue de Tourtille » Cette rue du XXe arrondissement qui n'est pas éloignée du « carrefour de Belleville », croise en fait la rue Ramponneau. L’heure indiquée par Tombs est 18 h. Il faudrait pouvoir en débattre avec ce chercheur car certains indices semblent contredire sa trouvaille, Tout d'abord, il y a les mémoires de l'illustrateur Albert Robida qui, 30 ans après, a rappelé l’ambiance qui régnait lors de la chute de Belleville où il habitait en 1871. En 1955, Michel Robida, dans sa chronique familiale intitulée Ces bourgeois de Paris, n'a pas manqué de reproduire le texte de son ancêtre relatant cet épisode du 28 mai, qui, par ailleurs a été repris dans le N° 477 d’Historia de septembre 1986. Robida nous permet ainsi de savoir que c’est à 11 h ou midi qu’une « colonne de chasseurs » est passé rue Julien Lacroix :
Ils allaient attaquer la dernière barricade, enlever le dernier drapeau rouge. L’armée de la Commune se réduisait maintenant à sept ou huit malheureux fous, désespérés, retranchés dans l’impasse Tourtille, défendue de trois côtés par une petite
barricade et un canon. Ils ont tenu là plus d’une heure, et se sont fait tuer jusqu’au dernier. Les chasseurs ayant perdu du monde, étaient exaspérés. C’est à la prise de cette barricade que Paul Déroulède a été blessé.
À 2 heures c’était fini.

Ces mémoires n'avaient sans doute pas échappés à Bruhat, Dautry et Tersen, qui, dans la Commune de 1871, un livre publié en 1960, avaient fait la synthèse entre les écrits de Robida et de Lissagaray « À deux heures, sur la barricade qui tenait le croisement de la rue de Ramponneau et de la rue de Tourtille, le dernier Fédéré - héros anonyme qui se battit seul pendant le dernier quart d’heure, lâcha son ultime coup de fusil » ; ils ajoutent en note : « Il put heureusement s’échapper ». Toujours dans cet ouvrage figure la reproduction d'un croquis de Robida avec cette légende :
La dernière barricade de la Commune (dimanche 28 mai, à 2 heures). Située à l’intersection de la rue de Tourtille et de la rue - plus exactement ancien chemin de ronde Ramponneau
En y regardant de près, on peut lire sur le dessin lui même de l’« écriture » de Robida :
La dernière barricade rue de Tourtille le dimanche 28 mai 2 h ;
la même reproduction figure dans le livre de Jean Braire Sur les traces des communards avec ce commentaire :
Celle ci, située à l’angle des rues Ramponneau et de Tourtille, est considérée comme le dernier bastion de la Commune. Le dernier coup de feu fut tiré à 16 heures.
J’ai voulu en savoir plus sur cette barricade et ses péripéties. Le dernier biographe de Déroulède, Bertrand Joly, dans son ouvrage La Ligue des Patriotes, Déroulède, l’inventeur du nationalisme, publié en 1998, a bien confirmé sa blessure sur une barricade lors des « ultimes nettoyages à Belleville » mais sans préciser l’heure et en situant ce fait « rue Curial ou rue de Puebla, actuellement Simon Bolivar », soit dans le XIXe arrondissement. J’ai donc demandé des précisions à cet historien. Il s'est montré très sceptique sur les récits oraux enjolivés que pouvait faire Déroulède à la fin de sa vie ; toutefois, bien qu’il ait laissé dire ses « biographes » de son vivant, il n'a jamais prétendu avoir pris d’assaut la dernière barricade de la Commune. Aucune preuve d'une telle action n’existe donc selon B. Joly qui, quoiqu’il en soit, demeure très dubitatif sur tout ce qui touche son personnage à l’époque de la Commune. Enfin, pour en finir momentanément avec cette question, je dois signaler qu’un rapport du Général de Division Montaudon, Commandant la 3e Division d'infanterie du 1er Corps d’armée de Versailles (dites Armée de Paris), précise :
à 10 heures du matin, le drapeau tricolore flotte sur l’église de Belleville, nos troupes s’arrêtent à la rue de Paris. Vers midi, une dernière action est engagée sur la droite, dans la rue d’Hunpoule (sic) une barricade armée de trois canons n’arrête qu’un instant nos Chasseurs ; une compagnie conduite par M. le lieutenant Déroulède est atteint d’une balle qui lui fracture le bras. Ce sont les derniers coups de ce côté.
Affaire à suivre donc. Mais revenons sur l’obsédante question du lieu.
La seconde barricade qui revient souvent clans les récits et les croyances est celle de la rue de la Fontaine-au-Roi, XIe arrondissement, quartier de la Folie Méricourt, sans doute parce que c'est sur cet édifice que la légende s'est le plus développée. Le fait que de nombreux auteurs aient mentionné la présence à cet endroit d'élus de la Commune et du Comité central de la Garde nationale n'y est pas étranger ; on cite le plus souvent les noms de Varlin, Ferré, Gambon, Geresme, Lacord, et plus particulièrement celui de Jean-Baptiste Clément, sans doute à cause de la fameuse Louise, l’héroïque ambulancière à qui sera dédié Le temps des cerises. Ajoutons ici que, selon un récit fait à Maxime Vuillaume en octobre 1871, repris par Georges Laronze en 1928, cette barricade, qui existait dès le vendredi matin 26 mai, aurait été défendu put Eugène Protot le délégué à la justice, élu du XIe et commandant du 213e bataillon ; il aurait résisté là jusqu’à 17 h « entouré de morts » avant d’être grièvement blessé.
Aujourd’hui, au n° 17 de 1a rue de la Fontaine-au-Roi, nous pouvons voir une plaque, apposée en 1991, pour le 120e anniversaire, par Pierre Mauroy 1er secrétaire du Parti socialiste, qui affirme que se trouvait ici « la dernière barricade de la Commune de Paris » et qu’elle succomba vers midi le 28 mai 1871, au terme de la Semaine sanglante ». Chez Fernand, restaurateur aux numéros 17-19, ces affirmations sont reprises sous la responsabilité de Louis Mexandeau, député du Calvados, qui s'occupait alors, comme Président, de la Commission d’histoire du P.S. L’épisode y est immortalisé par une fresque du peintre Patrick Allard qui orne un mur entier. Un texte de J.-B. Clément, reproduit à droite de cette oeuvre, vise à authentifier la scène dont nous pouvons douter.

L. Mexandeau, toujours enthousiaste, a pu reprendre sur place cette version de la fin de l'agonie de la Commune, lors d'une conversation entreprise avec un ami entre deux fernandises début 99. Dans un ouvrage récent des Éditions de l’Atelier, consacré à La Commune de Paris aujourd’hui, il reprend son évocation héroïque de « la dernière barricade » avant de conclure plus ou moins sur « le mythe de la Commune », une formule ambiguë qui laisse donc une large ouverture.
Ce qui est certain en revanche c'est le fait qu’il y eu de la résistance dans cette rue du XIe, un arrondissement ou les barricades ont été nombreuses - l'administration des Ponts et chaussées en a dénombré 73 - et que l’existence de cette barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi a été pour ainsi dire attestée par la « 3e liste (…) des barricades enlevées par les troupes de l’assemblée nationale sous les ordre de Mac Mahon, duc de Magenta, à Paris pendant les journées du 20 au 30 Mai 1871 ». Des sources officielles ou s’en réclamant existent donc. Il y a notamment le rapport du général Montaudon, Commandant du 3e Corps d'armée, qui, détaillant les opérations du 23 mai, en particulier celles des 36e et 31e de marche, a signalé que « la grande barricade de la rue du Faubourg du Temple est tombée à 3 heures de l’après-midi », après les barricades de la rue Saint Maur, « c’est pour les insurgés le signal de la reddition », « la guerre civile est terminée, l’insurrection est vaincue » (Lissagaray, qui confond cette barricade avec celle située plus bas, au coin de la rue de la Fontaine-au-Roi, indique en revanche comment elle a été tournée par les rues Bichat et Saint Maur, ce qui la situe à la hauteur de la station de métro Goncourt) Le général Appert, se fondant sur ce document, écrit dans son Rapport d’ensemble ; « À 5 heures de l’après midi, la lutte circonscrite à l’hôpital Saint Louis et rue du faubourg du Temple prenait fin ». Une version que l’on retrouve naturellement dans le rapport du Maréchal de Mac-Mahon, le commandant en chef de l’armée, publié dès 1871 avec d'autres documents sous le titre L’armée de Versailles. Dans l’ouvrage du lieutenant-colonel Rousset, en 1871, La Commune de Paris et en province (février-mai), publié en 1912, la proclamation de Mac-Mahon, au soir du 28 mai, qu’il cite sans prendre position, varie d'une heure :
Nos soldats ont enlevé à quatre heures, les dernières positions occupées par les insurgés.
On pourrait imaginer que les versaillais n’avaient pas forcément les raisons d'allonger dans leurs rapports la durée du combat final et que par conséquent l’horaire indiqué par leurs soins, à une heure près, est vraisemblable. Paradoxalement, ces officiers reconnaissent davantage que les historiens communards comme Lissagaray l’âpreté de la lutte sur « les dernières positions ». Est-ce seulement pour des questions de médailles et d’avancement ?
Les « défenseurs » de la « dernière barricade »
S'il est problématique de localiser la ernière barricade, il est encore plus difficile de se faire une idée sérieuse sur la question de savoir qui étaient les derniers « défenseur » de la Commune dont nous connaissons d'ailleurs très mal les effectifs. Fiaux, pour prendre son exemple, a estimé à « quelques centaines » les fédérés rejetés du Haut Belleville sur le Faubourg du Temple par l’armée. En ce qui concerne ce secteur, où ils se sont retrouvés pour mourir au coude à coude avec ceux qui s’y étaient déjà retranchés, nous trouvons la plupart du temps, grâce à des bons de réquisitions ou à des articles de presse « à chaud », la mention de petits groupes ou même d’individus solitaires, parfois des femmes. Lissagaray, dans Les huit journées… évoque ces alsaciens-lorrains qui avaient tenu en dernier puis dans sa grande Histoire de la Commune ces « cinq ou six gardes » du 191e bataillon qui, avec leur commandant, tiennent la barricade de la rue de Paris « au coin du boulevard et j’ajoute que des Chasseurs fédérés ont encore édifié le dimanche matin une barricade rue de Paris (rue de Belleville aujourd’hui) ».
Ces groupes étaient donc peu importants en nombre, ce qui a permis à des auteurs Versaillais de parler de « débris des dernières bandes communeuses » et les Fédérés passés à la baïonnette aux barricades de la rue de Paris et de la rue du Faubourg du Temple n’étaient probablement que de remarquables poignées d’individus. Des journalistes ont raconté aussi ces coups de feu tirés par des femmes isolées dans le dernier quadrilatère de la résistance à la Folie Méricourt ou près du « carrefour de Belleville » en haut du Faubourg du Temple. Peu d’informations et peu de sources donc.
À côté de cette indigence de renseignements sur les simples combattants(tes) s’est développé le mythe des dirigeants - chefs de guerre qui, pour de bonnes raisons politiques, a, semble-t-il, pris le dessus sur une réalité qui n'était pas du tout à leur avantage en ces jours tragiques.
C’est ainsi que beaucoup d’auteurs communards, relayés par des hommes politiques et des historiens, ont cherché pour « la cause » à mettre des élus ou des responsables de la Commune ou du Comité central de la Garde nationale en situation de derniers combattants des barricades : Jules Vallès rue de Belleville, Eugène Varlin rue du Faubourg du Temple, Zéphirin Camelinat rue d’Angoulème (Jean-Pierre Timbault actuelle) ou rue des Trois bornes… Le lieu peut changer d’ailleurs : en ce qui concerne ce dernier on pourra évoquer « Le 20e arrondissement qui tint jusqu’à l’extrême limite et où Camélinat combattit l’un des derniers » (1932) ou affirmer « ce fut l’un des derniers combattants de la dernière barricade, à Belleville » (1945). Les exemples ne manquent pas. L’un des plus caractéristiques est celui de la rue de la Fontaine-au-Roi.

Un mythe exemplaire : la barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi
La plaque apposée en 1991 est on ne peur plus claire :
Dans la rue de la Fontaine au Roui résista la dernière barricade de la Commune de Paris, défendue par ses chefs : Eugène Varlin, Théophile Ferré et Jean-Bptiste Clément ;
sur la Fresque du « bistrot » les Fernandises on voit aussi Charles Gambon et l'autre Ferré, Hippolyte, auxquels on peut ajouter Jean-Baptiste Geresme et Louis Piat, deux hommes du Comité central qui apparaissent dans quelques ouvrages. Ces noms sont généralement repris dans les récits héroïques qui évoquent l'agonie de cette barricade.
Cette accumulation de répétitions n’est pas convaincante pour diverses raisons. L’une d’elles réside dans les absences et les contradictions. Lissagaray, dans Les huit journées… , nous explique que le 27 mai la barricade de la rue du Faubourg du Temple/rue de la Fontaine au Roi, est attaquée par le général Douay et ses troupes qui la contournent par la rue Grange aux belles, les Fédérés tirant là leur dernières cartouches :
vers cinq heures du soir ils étaient tous tués.
Dans sa grande Histoire de la Commune, il nous raconte tout autre chose puisqu'il met en scène « une petite phalange dont Varlin Ferré Gambon » qui, vers 10 h, le dimanche 28, passe du XXe dans le XIe pour se rendre jusqu’à la barricade de la rue de la Fontaine au Roi et de la rue du Faubourg du Temple ; en tête, un « garibaldien d'une taille gigantesque » portant « un immense drapeau rouge ». Rien sur l'effectif, pas grand chose sur la prise de la barricade tant au niveau du combat qu’à celui de sa chute :
Elle est inabordable de front, de face ; les versaillais, maîtres de l’hôpital Saint Louis parviennent à la tourner par les rues Saint Maur et Bichat.
Un coup d’œil sur un plan de Paris nous laisse dubitatif. J’y reviendrai plus loin.
Pour l'effectif de la fameuse « phalange » il faudra attendre des articles commémoratifs de Jean Baptiste Clément. Ces « derniers combattants » de la Commune, qui étaient repliés depuis la veille à la mairie du XXe arrondissement, se seraient réunis le dimanche matin - ici Jean-Baptiste Clément, soucieux de mettre un certain ordre dans l'épisode, dit que cette réunion a été à « l’initiative » de « quelques membres de la Commune » donc des élus - pour décider de ce qu’il convenait de faire : l'effectif du « bataillon du désespoir », qui s'ébranle en direction du centre de Paris, s'élève, selon un article paru dans L’Émancipateur de Charleville du 28 mai 1893, à 4 à 500 hommes « au départ » pour fondre progressivement ; arrivé rue Saint Maur, il ne compte plus que 2 à 250 Fédérés. Et nous apprenons. par l’explication de sa dédicace du Temps des cerises à Louise, en 1885, au moment de la publication du recueil de ses chansons, qu’il n’y avait plus que « quelques hommes » derrière la barricade de la rue de la Fontaine au Roi, c’est à dire une « vingtaine », à savoir les deux frères Ferré, le « citoyen Gambon », auxquels s'ajoutaient des « jeunes » et des « barbes grises » de juin 48.
Cette dispersion du « bataillon » descendu de Belleville, absolument typique du style communard mêlant autonomie et indiscipline, est bien entendu en totale contradiction avec les récits « hiérarchiques » que Clément a produit, particulièrement celui de 1993. On imagine mal en effet les Fédérés s’alignant en rangs bien ordonnés derrière leurs « élus » et un « chef de légion » comme il a voulu nous le faire croire. Notons d’ailleurs, entre autres variations que J.-B. Clément, dans son article de 1899 intitulé « Le 27 Mai 1871, Souvenirs », corrige quelque peu ses dires précédents : après la « résolution » prise par les membres restants de la Commune et du Comité central et communiquée aux Fédérés rassemblés place de la mairie ceux ci, derrière « leur drapeau rouge », descendent de Belleville au nombre de « deux ou trois cents ». Ce départ de l'ancienne mairie du XXe avant l’arrivés des troupes versaillaises est quoiqu'il en soit authentifié par les déclarations de Louis Fortuné Piat dans le cadre du procès organisé en mars 1872 par le 6e Conseil de guerre pour l'affaire des otages de la rue Haxo, mais celles-ci introduisent dans cette histoire de nouvelles questions :
Piat. - j'ai passé la nuit dans la mairie de Belleville et, le matin, vers 7 heures, je descendis vers l’intérieur de Paris, faisant partie d’un groupe d’environ trois cent cinquante hommes ; mais tout était occupé par des troupes et nous fûmes contraints de nous retirer rue Fontaine-au-Roi.
M. le Président. – Vous vous êtes retiré rue Fontaine-au-Roi, dites-vous ; c'est-à-dire que vous vous êtes ralliés derrière la barricade de la rue Fontaine-au-Roi, où vous avez été pris les armes à la main.
Piat. – La vérité est que les deux barricades ont été rendues par nous sans coup férir. Je vis qu’il était inutile de résister, et je déclarai aussitôt à mes hommes qu’il fallait se rendre. L’un d’eux attacha son mouchoir blanc au bout d’une perche qu’il planta sur la barricade. Au même instant arriva un détachement de troupes de ligne qui se plaça derrière une voiture de marchand d’eau de seltz.
Aussitôt je m’avançai seul, deux coups de feu tirés sur moi sans m’atteindre ; le lieutenat qui commandait le détachement fit cesser le feu et je m’approchai sur mon affirmation que nous étions disposés à nous rendre : « Faites vite, me dit-il et amener vos hommes sans armes ».
On nous emmena aux Buttes Chaumont. On nous fouilla, et quant on eut examiné mon livret sur lequel je portai le titre de membre du comité central, on me garda de plus près.
Le bruit courait qu’on venait de prendre Félix Pyat. On s’apprêtait à me fusiller quand l’idée me vint d demander à être conduit devant l’officier commandant la division.« Pouvez-vous prouver que vous n’avez pas tiré ? » me dit le commandant. Je fis le récit des efforts que j’avais fait pour arrêter le massacre de la rue Haxo. N’était-ce pas moi aussi qui avait rendu la barricade ? « C’est bien, me répondit le commandant : reconduisez cet homme ; il sera conduit à Versailles. Je ne peux pas prendre sur moi de le faire fusiller.

Plan de Paris avec indication exacte des Maisons et Monuments incendiées, des Batteries et Barricades construites en mai 1871. (Carcireux, A. (éditeur)) Visible ici
Ces déclarations ont de quoi laisser perplexe. L’affaire de la barricade de la rue Fontaine-au-Roi s’embrouille encore davantage en ce qui concerne d’une part l'implantation de l’ouvrage et d'autre part le combat puisque Piat se serait rendu là aux Versaillais avec une soixantaine d'hommes comme n’a pas manqué de le signaler le docteur Louis Fiaux en 1879, dans son Histoire de la guerre civile de 1871 (Le dossier de grâce de Piat n’en compte que vingt). Cet auteur ajoute que Varlin et Gambon tentent de résister dans le Faubourg du Temple rue Oberkampf et rue Saint Maur. Si l’on s’en tenait à ce livre et aux dires de Piat, on devrait pouvoir affirmer qu'on a pas, rue de la Fontaine-au-Roi, tiré jusqu'à la dernière cartouche, qu'il n’y a quasiment pas eu de combat et que ni Varlin, ni Gambon, ni Ferré n'y étaient. Méfions nous tout de même de ce que peuvent dire les accusés devant un conseil de guerre où ils risquent tout simplement leur peau. En dehors des déclarations de Piat, je n'ai trouvé que celles d'un prévenu, Meunier Jules, 19 ans, typographe, garde au 83e bataillon, qui a été arrêté sur les lieux le 28 mai et qui, selon le 4e conseil de guerre, « s'est battu jusqu'à la fin contre les troupes ». Son parcours de la semaine sanglante peut nous faire comprendre pourquoi il a accepté de se rendre, peut être en compagnie des hommes de Piat dont il ne dit mot. Le mercredi 24 mai, avec des gardes de son unité, il combat à la barricade du coin de la rue de Rennes et de la rue du Vieux colombier, avant de se replier sur le Panthéon puis au Pont
d’Austerlitz et à la mairie du XIe. Il participe alors aux travaux de fortification et de retranchement :
Le samedi matin. Le capitaine qui commandait le Bataillon a reçu l’ordre de nous conduire à Belleville où nous avons tiraillé toute la journée contre les troupes qui occupaient la nouvelle mairie ; dans la soirée on nous a ramenés sur la place de l’Eglise et là, le capitaine nous a dit que nous étions libres de faire ce que nous voudrions pour nous sauver. Le Bataillon s’est dispersé, j’ai rencontré des gardes nationaux du 115e Bataillon que je connaissais. Je suis allé me coucher avec eux dans la maison qu’ils occupaient, et le lendemain matin, nous sommes allés tous ensemble défendre la barricade de la rue Fontaine-au-Roi. Vers les deux heures de l’après-midi, voyant que nous étions cernés, nous avons arboré le drapeau blanc et nous nous sommes rendus à la troupe.
Ces paroles nous renseignent plus sur l’improvisation militaire des Fédérés, leur spontanéité, et l’état d’épuisement dans lequel ils se trouvaient forcement, que sur les conditions réelles de leur dernière lutte. J. B. Clément, plus tard, nous en a conté davantage. Néanmoins, avant de revenir sur ses textes, qui décrivent un combat et ses péripéties, il nous faut signaler une autre bizarrerie qui peut introduire un dernier doute. Il s’agit du récit de Camélinat à Maurice Foulon, l’un des biographes de Varlin. Ce dernier serait descendu de la rue Haxo avec Piat et Camélinat le 27 mai ; ils se seraient quitté « le cœur étreint », boulevard de Belleville. Piat et Varlin auraient ensuite fini par rencontrer une barricade, « au coin des rues Saint-Maur et de la Fontaine-au-Roi », où ils se seraient défendu « chassepot en main, jusqu'au lendemain midi », Piat se rendant ensuite avec ses soixante fédérés tandis que Varlin s’échappait pour rejoindre une autre barricade rue Ramponneau.
Dans cette version de 1879, nous n'avons donc plus de « conciliabule » à la Mairie du XXe, plus de descente des faubourgs par une troupe armée de plusieurs centaines d’hommes. Cela n’est finalement pas vraiment surprenant puisque chaque auteur y va de sa fantaisie, au gré des synthèses. Bruhat, dans sa biographie de Varlin, estime, en s’appuyant sut un article de Jules Vallès de 1879, que son personnage s'est battu rue Oberkampf et rue Saint Maur en compagnie de Gambon dès le 27 mai, après avoir fait battre la Générale et le Rappel à Belleville « pour rassembler les bataillons ». Michel Cordillot, dans son Eugène Varlin chronique d'un espoir assassiné, à tout d’abord suivi la piste Camélinat, Dans son livre Varlin et Gambon « galvanisent les dernières énergies » dans les rues du XXe depuis le samedi. C'est depuis ces barricades qu’ils « imaginent » avec Ferré « l'ultime coup d'audace de la Commune » qui consiste. selon cet auteur, à passer du XXe dans le XIe où ils rejoignent le « réduit » de la Folie Méricourt pour se battre plusieurs heures jusqu'à épuisement des munitions rue de la Fontaine-au-Roi, Varlin réussissant à s'échapper de cette souricière.
Pour essayer d'y voir plus clair il est, à mon avis, indispensable d’examiner les articles de J.B. Clément qui, après tout, était présent rue de la Fontaine-au-Roi.
Nous avons vu que celui ci, à diverses reprises, a décrit la nuit du samedi au dimanche, puis le cheminement de la troupe communarde depuis la mairie du XXe, son égrenage - il a d’ailleurs signalé que Varlin est resté à la barricade de la rue Saint Maur et n'a donc pas été jusqu'à la barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi – et son arrivée sur les lieux.
Ce mouvement, qui ne s’inscrivait pas dans une quelconque stratégie, n’avait pas été prévu à l'avance. Personne ne s'était présenté à la mairie du XXe pour demander du renfort, Les « dirigeants » pensant que la poursuite de la lutte était inutile, envisageaient une reddition partielle, ce que les gardes nationaux avaient absolument refusé, une attitude que reconnaît Clément : « ils étaient les premiers à vouloir se défendre jusqu’au bout », en clair jusqu'à la mort. Néanmoins en 1893 il nous laisse tout d’abord entendre qu’il y avait cette idée partagée par tous d’aller finir « en plein quartier de réaction », sur « la place de la bourse » par exemple « et d’y vendre chèrement sa vie », avant de préciser en 1899 que c’était les Fédérés qui voulaient « vendre chèrement leur vie »
C’est donc par hasard que les communards recommencèrent le combat dans cette rue de la Fontaine-au-Roi. La barricade située au bas la rue, à l'intersection de la rue de la Folie Méricourt et de la rue du Faubourg du Temple, était tombée la veille. Dans son article de 1893, il nous dit contradictoirement qu'elle avait été reprise le dimanche matin tout en expliquant que la petite troupe arrivée à la moitié de la rue — disons à la hauteur de la rue adjacente de la pierre levée — avait essuyée le feu des versaillais retranchés en bas de la tue de la Fontaine-au-Roi. Un « restant de barricade » fut alors relevé et une fois le drapeau rouge planté, le combat commença. À 9 h du matin, indique Clément. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour compter deux barricades dans cette portion de la rue Fontaine-au-Roi, une communarde et une versaillaise.
Les différentes relations du combat, curieusement succinctes d'ailleurs, me laissait rêveur. En 1885, dans sa dédicace à Louise, Clément écrit « quelques hommes luttaient encore dans la rue Fontaine-au-Roi » signalant un blessé et un mort avant d'ajouter : « j'en passe !!! » (comprenne qui pourra ! NDR). En 1893, il regrette d’en dire si peu sur le combat car la place lui manque : « j’espère bien pouvoir le faire un jour ». Il mentionne « quelques camarades tués ou blessés » et « l’impétuosité » des « valides qu'il faut calmer car à tout instant, il voulaient se précipiter en avant et courir à l'assaut de la barricade ou les Versaillais, prudemment retranchés, ne se montraient pas, tirant à coup sûr, même des fenêtres des maisons, abrités derrière des matelas et n’attendant que le moment où notre petite troupe se serait avancée pour la fusiller a bout portant ».
On apprend là qu'à midi les munitions « commencent à manquer » sans que des précisions aient été données auparavant sur leur quantité en 1897, dans l'article de la Petite République du 24 mai intitulé « Le dernier coup de Fusil », les détails sont un peu plus nombreux. L’arrivée dans la rue se solde par deux blessés, puis, après que les communards se soient abrités derrière « la barricade abandonnée », que les dirigeants Gambon, Ferré et Géresme aient établi « leur quartier général dans une maison voisine » et que la lutte se soit engagée, « plusieurs morts et blessés ».

Comme nous ne connaissons pas le nombre initial de combattants, qui n’est pas précisé par Clément dans cet article, nous ne pouvons chiffrer le nombre de ces pertes sur lesquelles notre poète se fait discret puisque, nous allons le voir, il se pose en sauveur. Heureusement, nous avons un récit de sa femme, qui, dans la mesure où elle le tient de leur vie intime, n’a pas été édulcoré pour des raisons politiques, or celle ci, dans Le Socialiste Ardenais, a rapporté ces mots terribles de son mari « les cadavres des nôtres jonchaient le sol ». Une réclamation au préfet, postérieure à la Commune par un certain Barthe. qui habitait au n° 115 rue de la Folie Méricourt, un immeuble qui faisait le coin avec la rue du Faubourg du Temple et le quai de Jemmapes et faisait quasiment face a l’entrée de la rue de la Fontaine-au-Roi, nous fait comprendre que la lutte a été chaude :
la barricade établie devant cette maison ayant été la dernière position enlevée le 28 mai par l'armée, aucun secours n'a pu être apporté et il n'est reste que des cendres.
Mais reprenons la lecture du journal Le Socialiste Ardenais : l'affrontement, aveugle semble-t-il, se prolonge jusqu'à 13 h, malgré une pénurie de munitions depuis midi. La barricade de la rue Saint Maur étant tombée. Les Fédérés se trouvent à découvert. Encore une Fois, les « membres de la Commune », estimant le combat inutile — il n’y a guère que Lacord pour vouloir édifier une nouvelle barricade afin de se protéger de la rue Saint Maur — incitent les hommes à cesser le combat et à se disperser.
Si Clément insiste sur ce « conseil », c’est bien entendu pour prouver que les élus ont fait leur « devoir ». Ils seraient, d’après lui, partis les derniers, quittant la rue par un passage. Toutefois, il faut bien faire état de ces réticences des Fédérés quant au « repli » proposé. Le porte-drapeau, un maréchal-ferrant, refuse tout net, préférant « mourir ici » plutôt qu’à Cayenne, et il n’est pas le seul. Clément le retournait indirectement en racontant cette anecdote du « vieux à la barbe grise, encore en uniforme de fédéré », qui abat, après la cessation supposé du feu, un sergent de la ligne qui s’était emparé d'un drapeau rouge. La « citoyenne » Clément, racontera d’ailleurs dans Le Socialiste Ardenais que le maréchal-ferrant s’est fait tuer sur la barricade une demie heure après le départ de son mari. Qu'est devenue la vingtaine de défenseurs rescapés de la barricade ? Clément, qui a trouvé un refuge chez une de ses connaissances, avoue qu’il n’en sait rien. Et il en est de même pour Louise, cette ambulancière qui les avait rejoint. Je ne sais pas si ces communards inconnus ont encore tenté quelque chose avant d’essayer de s'échapper. Georges Laronze, dans Histoire de la Commune de 1871, l’affirmait :
Au début de l'après-midi, comme en un geste de défi suprême, quelques désespérés construisirent une barricade au coin de la rue de la Fontaine-au-Roi et de la rue Saint-Maur. Ils y plantèrent un drapeau rouge et l’abandonnèrent.
0nt-ils fait partie de ces milliers de personnes prises par l’armée dans le secteur et exécutées sommairement sur place ou conduites à Versailles et à la Roquette où nombre d’entre elles allaient disparaître ? Un rapport du Général Montaudon relate qu’à 3 heures de l’après midi du 28 mai, au moment où l’insurrection est vaincue « De nombreux convois de prisonniers arrivent de tous côtés, leur nombre s’élève à près de 3 000 (…) Tous ces prisonniers sont remis à la brigade du Général Lefèvre pour être conduits à Versailles ». Par ailleurs, un document de la Prévôté de la 1ère Division, du 28 mai, compte 3 778 prisonniers faits dans le secteur et « envoyés à la Roquette », tandis qu’un autre, daté du 30 mai, émanant du Quartier général de la Roquette, parlant d’insurgés du XXe arrondissement, énonce simplement :
ces derniers ont été pris ou fusillés.

Une femme à la rescousse
La légende de la barricade de la tue de la Fontaine-au-Roi va prendre de l’ampleur avec l’apparition dans la « mémoire historique » d'une jeune ambulancière surgie de la bataille des rues : « la vaillante Louise ».
C'est à ce personnage extraordinaire que J.-B. Clément va dédier sa fameuse chanson de 1867 Le temps des cerises lorsqu'il publie le recueil de ses chansons en 1885. Grâce à des discussions avec Bertrand Tillier, qui n’a pas ménagé ses judicieux conseils, et à des recherches encore plus fouillées, je suis de plus en plus persuadé que le tableau de Steinlen, datant de la même année et intitulé Louise Michel sur les barricades représente en fait Louise que nous retrouvons dans sa lithographie en couleur qui a fait la première page du Chambard socialiste : du 26 mai 1894.
Cette litho, que le musée de Genève a répertorié sous le titre Marie Louise, est connue jusqu’en Russie comme étant Le mois de Mai 1871. Grâce à Michel Dixmier, qui m'a permis de consulter sa collection, j’ai pu vérifier que le titre exact donné dans le journal de Gerault Richard par Steinlen était « MAI 1871 » et qu’aucun autre élément d’explication n’y figurait. Georges Guyonnet, l'auteur d’un article sur Le Temps des cerises. Une romance fille adoptive des barricades publié dans Le Miroir de l'histoire N° 103, de Juillet 1958, a cependant affirmé que le personnage en question, une « furie dépoitraillée », était la « douce et vaillante » Louise. Pour ma part, après avoir dépouillé les cartons et les catalogues d’expositions du musée d’Orsay, j’estime que rien’ jusqu’à preuve du contraire, ne s’oppose à l’hypothèse que j’ai défendu lors du colloque de mai 1995 sur La barricade à savoir que Steinlen n'avait pas représenté Louise Michel dans son tableau de 1885 et qu’en conséquence le titre retenu n’était pas son fait. Selon toute vraisemblance, il s’agit donc de Louise, qui est, soulignons le, représentée quasiment de la même façon sur le tableau et sur la lithographie.
Cet épisode romantique mis en scène par Clément et plus que probablement par Steinlen, s’ajoutant aux récits du cheminement uni des derniers combattants depuis Belleville, ne pouvait-il être une façon de remettre en selle, au delà du temps, une « avant garde révolutionnaire » quelque peu malmenée par ses mandants ? Les dirigeants, qui voulaient sauver la Commune et les communards, ont très mal vécu cette semaine sanglante au cours de laquelle les Fédérés avaient encore accentué leur tendance à l’autonomie au point de les menacer de mort, le mot de « trahison » courant partout contre les porteurs d’écharpes ou de galons. Rue Haxo, le 26 mai, ils n’ont pu empêcher l’exécution des otages. Le lendemain 27, la réunion d’une quinzaine de « chefs » a quelque chose de pathétique. Ils sont coupés de leurs troupes. Personne n'écoute sérieusement leurs appels. N’y avait-il pas alors dans cette confusion deux Délégués à la Guerre concurrents, Parent du Comité central et Varlin de la Commune ? Les derniers « conciliabules » au « sommet » du samedi, relatés par Lissagaray ou d'autres, nous montrent des leaders divisés sut ce qu’il convient de faire, si l’on fait exception pour le blanquiste Gabriel Ranvier…

Cette poignée de « responsables » désorientés, bien près de sombrer dans le désespoir, ne pouvait pas, bien entendu, mener une quelconque opération militaire et il est plus que probable qu’ils ont plutôt accompagné les groupes en déplacement, et erré près ou sur les barricades au lieu de les commander. La barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi n'est donc pas le dernier carré des grognards à Waterloo et Varlin, qui d'ailleurs n’y était pas, n'est pas Cambronne, mais un événement hasardeux et mal défini qui dépasse quelque peu ses acteurs du Côté communard. Il faut pourtant distinguer les « leaders » de la « base ». Sans sous estimer le courage de ces hommes dévoués au peuple, il m'a semblé nécessaire d’évaluer leur rôle exact dans cette fin de la guerre des rues. Avant ce baroud d’honneur du 28 mai, certains d'entre eux ont tenté de sauver la situation. Lacord qui, selon ses propres écrits « flairait un 18 mars », a été, semble-t-il, l’auteur de l'appel aux soldats de Versailles les invitant à mettre crosse en l’air. Une fois encore, Ferré, en bon blanquiste, a sans nul doute cherché le salut du pouvoir communaliste dans une solution politique jusqu'au 27 mai. Il ne s'agit donc pas ici de dénigrer ces militants révolutionnaires mais de comprendre que, malgré leur sort tragique – victime de leur engagement, ils vont périr pour quelques uns d’entre eux sous les coups et les balles des partisans de l’ordre – ils vivent, au niveau de la conscience, un destin forcément différent de ceux qu'ils désignent parfois, à l'instar de J.-B. Clément, comme des « las de vivre ». À mon sens, certains problèmes du mouvement ouvrier, qui vont rebondir jusqu’à nos
jours, commencent avec la Commune. Reste que la « mémoire » - un mot qui autorise beaucoup de fantaisies - a introduit une note de romantisme dans ces horreurs de la semaine de mai. Le personnage de Louise permet en effet d'opposer la fraîcheur d’un symbole juvénile au vieux monde qui n’apparaît plus que comme la mort. Dans le tableau et la lithographie de Steinlen, cette allégorie réaliste de la Commune, va être hachée par la mitraille. C'est bien la jeunesse enthousiaste, extrémiste, donc la Révolution, que les balles des assassins anonymes et sans âmes de Versailles vont faucher. Louise n’est pas Marianne : la Sociale est plus que la République. Le rapprochement de cette ambulancière hautement significative avec les élus communards dans cette légende partagée témoigne donc en même temps de la force du souvenir du passé révolutionnaire et des réalités de cette république « bourgeoise » qui triomphe en cette fin de siècle. Louise, qui devient ainsi source de légitimité, est une référence que les républicains « modérés » ne peuvent invoquer.
Mais soulignons ici que Clément, son « laudateur » sinon son « inventeur », s‘il reste un idéaliste, participe, comme la plupart de ces anciens « collègues » survivants, aux institutions de cette République qui ne le satisfait pas pleinement mais dont il s’estime sans doute, malgré tout, l'un des sauveurs, à la façon de Vallès rapportant en 1879 quelques uns des derniers « mots » de Varlin :
Oui, nous serons dépecés vivants, morts, nous seront traînés dans la boue (…)Mais l’histoire finira par voir clair et dira que nous avons sauvé la République.

La méfiance et la mort pour finir
Les termes même de « dernière barricade de la Commune » expriment un besoin : celui d’avoir en mémoire un acte héroïque qui clos une épopée sociale. L’image romantique d’un sacrifice conscient qui servira aux futures générations de révolutionnaires. Mythe et symbole tout à la fois. En fait nous avons vu qu’il n'y a pas eu une dernière barricade où l'on aurait vendu « chèrement sa peau » mais une zone ultime de résistance où les communards submergés et acculés ont tait ce qu’ils pouvaient dans une ambiance de division. On se défiait des « chefs » chez les Fédérés. Les gardes nationaux étaient furieux vis à vis de leurs élus ou de leurs délégués. Nous en retrouvons l’écho jusque dans les textes commémoratifs de J.-B. Clément qui, malgré ses récits « unitaires », doit reconnaître qu'on murmurait dans les rangs surtout lorsqu’il était question de reddition. Ceux que l’on a désigné comme des « enragés » étaient donc bien décidés à aller jusqu'au bout. David, dans Le Prolétaire, l’ « organe des revendications sociales » du XIe arrondissement, avait écrit le 24 mai :
Il faut marcher cette fois ou mourir en lâche, car, sachez le une fois pour toutes, Paris sautera plutôt que de se rendre ; femmes, enfants, aux barricades et réfractaire ou lâche que vous verrez ne rien faire, fusillez le, c’est votre droit et votre devoir ; agissez, agissons tous et sauvons la Commune et la République.
Ce sont ces révolutionnaires anonymes qui sont tombés sur les dernières barricades ou devant des pelotons d’exécution sommaire dans des circonstances mal connues. Ceux là n'ont pu témoigner de leur propre mort et n’ont donc pu réécrire l’histoire de ces jours tragiques comme certains « chefs » survivants.
Alain Dalotel
Article paru dans Gavroche, revue d'histoire populaire N° 111-112 de mai-août 2000.
Gavroche est une revue d'histoire populaire trimestrielle créée en 1981. La revue a cessé d'être publiée depuis le numéro 166 d'avril-juin 2011. La totalité de la revue Gavroche a été mise en ligne sur le site http://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique263