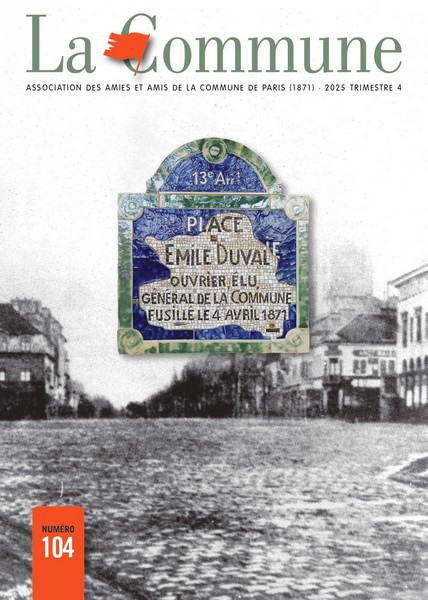Alors que reparaissent ses œuvres, un petit rappel semble nécessaire... Alphonse Daudet, lui aussi, aimait cracher sur la tombe des Communards !
Fréquemment dans nos bulletins, nous avons eu l'occasion de dénoncer le comportement abject d’écrivains célèbres envers la Commune, justifiant, tout en l’exaltant, l’odieuse répression et ce parlons, bien après coup, tel Zola dans « La débâcle ».

Il ne s'agit pas d'ouvrir de nouvelles polémiques qui feraient naître des controverses sur le bien-fondé de cette intervention en opposition avec les circonstances de l'époque, mais de parler d'un écrivain qui, lui aussi, joignit sa voix au concert d’opprobre contre les Communards. Comme ses réputés amis, banquetant chez Brébant, il n'eut pas de compassion pour les vaincus, mais bien au contraire, dans ses écrits paraissant légers, il laissa aller sa plume en des jugements infâmes. Lui qui, de « Tartarin » à « La chèvre de M. Seguin, avait su allier le rire à I ‘émotion, se compromit honteusement. Et pourtant, telle « l'Arlésienne » qu'il imagina, il tira son épingle du jeu en figurant rarement dans la mémoire collective de la galerie de ces procureurs implacables que furent Zola et Flaubert entre autres.
Dans « Les contes du lundi » Alphonse Daudet annonçait la couleur. Certes, on a souvent relevé le « Turco de la Commune » où se trouvent rassemblés l'esprit colonial ainsi que la haine anticommunarde, mais il y a bien d'autres contes où la verve versaillaise frelatée n'y va pas par quatre chemins. Ainsi, dans « Paysages d’insurrection », lit-on :
« J'ai trouvé là les anciens de 48, égarés éternels, vieillis mais incorrigibles, l’émeutier en cheveux blancs, et avec lui le vieux jeu de la bataille civile...»
du pur sucre Gallilet, vous savez ce « brave » général dont la moustache frétillait d'aise rien qu'à désigner les hommes à cheveux blancs, ces incorrigibles, à rejoindre leurs compagnons de 1848 pour être fusillés. Dans « la mort de Chauvin » :
« Puis, les jours d’émeute arrivèrent, le drapeau rouge, la Commune, Paris au pouvoir des nègres ».
Là encore, le couplet colonial ne manque pas.
Dans « Le concert de la huitième » :
« De grandes flammes ambrées de fumées noires qui frappaient en plein sur toutes ces têtes d'ouvriers vulgaires, abruties par l'ivresse... »
poursuivant cette description, il ajoute :
« Nous eûmes d'abord l’ouvrier penseur, le mécanicien à longue barbe, chantant les douleurs du prolétaire. »
Ce qui en dit long, à savoir pour lui, qu'un ouvrier est capable de penser et sur ses doutes sur le bien-fondé des plaintes du prolétariat.
Dans « La bataille du Père-Lachaise » sa hargne ne désarme pas :
« C'était pourtant un ramassis de bien vilain monde, ces artilleurs de la Commune.»
En voulez-vous encore l dans « Les petits pâtés », « Monologue à bord » et «Les fées de France», tout est du même tonneau. Il n'empêche que, donnant la parole à un menuisier dans « les trois sommations » celui-ci s'écrie :
« Si le père Thiers s'imagine que la bonne leçon qu'il vient de nous donner aura servi à quelque chose c'est qu’il ne connaît pas le peuple de Paris. Voyez-vous, Monsieur, ils auront beau nous fusiller en grand, nous déporter, nous exporter, nous mettre Cayenne au bout de Satory, bourrer les pontons comme des barils à sardine, le Parisien aime l'émeute et rien ne pourra lui enlever ce goût là ! »
Encore que ces propos visant Thiers et « la bonne leçon » soient à prendre avec des pincettes, on trouve ici l'incompréhension du bourgeois frileux. Celui qui rallia tout naturellement la cohorte de ces écrivains en mal d'aimer le peuple, de ne l'estimer que calme et obéissant. N'en déplaise à ce bon Armand Lanoux qui voyait Alphonse Daudet
« avec de la bonté derrière ses ironies parfois cruelles, contradictoires » ses écrits témoignent du parti que l’on prend. Si bonté, il détenait, ce n’était assurément pas pour les Communards, mais pour ceux qui professaient les versaillais. Après tout, diront certains, ce n’est là que « petite chose ».
Robert Goupil