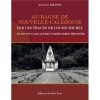Entre leurs dirigeants, leurs pères, leurs patrons, et leurs compagnons, les chemins escarpés de l’émancipation des femmes sous le Second Empire
« Je vois deux peuples dans nos villes », avait écrit Jules Michelet dans « La Femme », mettant ainsi en confrontation ou en comparaison les prolétaires et « les prolétaires des prolétaires », leurs femmes.
À la veille du 18 mars 1871, la « question » des femmes est aussi centrale pour le mouvement socialiste que celle des ouvriers. Malheureusement, la plupart de ces interrogations, soulevées, exposées et discutées le plus souvent par des hommes, suscitent des réponses paternalistes dans le meilleur des cas, méprisantes ou insultantes, dans le pire. À la veille de la Commune, les femmes ont compris qu’elles devaient d’abord compter sur elles-mêmes pour améliorer leurs conditions de vie ; pour s’imposer sur le terrain politique (et jusqu’en 1944, le suffrage universel ne restera que demi-universel) ou social ; pour donner sens à leurs aspirations culturelles, artistiques ou amoureuses ; pour sortir de l’antique dichotomie qui depuis des siècles les divisent en courtisanes ou ménagères, est toujours à l’œuvre non seulement chez les réactionnaires mais aussi chez les révolutionnaires, puisque Proudhon en a fait l’un des fondements de ses théories (notamment dans « De la justice dans la révolution »).
1 – La régression à l’œuvre
Les femmes, en cette deuxième moitié du XIXe siècle sont les premières victimes de la révolution industrielle et capitaliste, impulsée depuis 1847 par le président du Conseil François Guizot. En 1866, si l’agriculture fait encore vivre la majorité des Français, la mécanisation du travail pousse de plus en plus à l’exode rural. Et déjà, alors, les femmes constituent 33% de la population active. Une population qui se concentre principalement dans les manufactures du vêtement, à domicile, en ateliers ou en usines ; mais ce secteur n’est pas exclusif, puisqu’elles ne rechignent pas aux travaux « masculins », comme les mines ou le terrassement pour la construction du chemin de fer.
Les années trente ont esquissé les prémices de cette organisation du travail féminin. Avant d’être saint-simonienne et sage-femme, Suzanne Voilquin est brodeuse (sa compagne de combat, Marie Reine, est lingère). Dans ses « Souvenirs d’une fille du peuple » [1], elle nous fait visiter quelques uns de ces innombrables ateliers, à mi-chemin du travail à domicile et de l’usine, mélange de gaieté et de solidarité dans ce monde du fil et de l’aiguille, mais aussi véritables bagnes très hiérarchisés, où l’on travaille jusqu’à 13 ou 14 heures par jour, pour des salaires quotidiens très disparates, de 40 centimes à 4 francs (une chambre est louée entre 100 et 200 francs par an).

Si le travail à domicile garde la préférence des ouvrières, c’est qu’il leur permet de concilier revenu et ménage : en 1860, elles sont encore plus du tiers de ce secteur, dans le Nord du pays, à broder, tisser ou filer chez elles. Mais celles-là seront les premières victimes de la concurrence des machines : désormais sans travail, lorsqu’elles rejoindront les manufactures, sans formation sur ces nouvelles machines, elles devront se contenter des basses besognes, tandis que les hommes occuperont leurs anciens métiers. Et avec la déchéance sociale arrive la déchéance sanitaire :
« On voit des éplucheuses et des cardeuses condamnées à vivre au milieu d’épais nuages de poussière, pendant que les fileurs et les rattacheurs respirent librement dans de vastes ateliers bien aérés. (…) Dans les ateliers de passementerie, quelques femmes sont obligées de travailler presque suspendues sur des courroies, en se servant tout à la fois de leurs pieds et de leurs mains. »,
nous décrit Auguste Blanqui après avoir visité des ateliers lyonnais.
Ces nouvelles conditions de travail favorisent aussi le harcèlement sexuel des patrons ou des cheffaillons. Certaines sont également poussées à la prostitution. À la veille du printemps 1871, Victorine Brocher, arrivée d’Orléans, était ouvrière piqueuse de bottines à Paris. Voici ses premières impressions parisiennes :
« Dans cette première année, j’ai fait bien des expériences, j’ai coudoyé bien des misères. J’ai vu des pauvres femmes travaillant douze et quatorze heures par jour pour un salaire dérisoire, ayant vieux parents et enfants qu’elles étaient obligées de délaisser, s’enfermer de longues heures dans des ateliers malsains où ni l’air, ni la lumière, ni le soleil ne pénètrent jamais, car ils sont éclairés au gaz ; dans des fabriques où elles sont entassées par troupeaux, pour gagner la modique somme de 2 francs par jour, dimanche et fêtes ne gagnant rien. Souvent, elles passent la moitié des nuits pour réparer les vêtements de la famille ; elles vont aussi porter au lavoir leur linge à couler, pour aller le laver le dimanche matin. Quelle est la récompense de ces femmes ? Souvent anxieuse, elle attend son mari qui s’est attardé dans le cabaret voisin, et ne rentre que lorsque son argent est aux trois quarts dépensé. (…) Résultat : la misère noire ou la prostitution. Un écrivain a dit : ‘Paris est le paradis des femmes et l’enfer des chevaux.’ Moi, je dis : ‘Paris est le paradis des demi-mondaines et des chevaux de luxe, l’enfer des honnêtes travailleuses et des chevaux de fiacre. Tous les deux entrevoient la mort comme une heureuse délivrance. Voilà leur idéal ! » [2]
En 1873, le « sociologue » Leroy Beaulieu publie les fruits d’une enquête (commencée avant la Commune) sur le travail des femmes. Il y dresse la liste des pathologies féminines aggravées, voire causées par leurs conditions de travail : avortements spontanés, intoxications, ophtalmies, phtisies cotonneuses ou dérèglements de la menstruation, pour en citer quelques-unes. La précédente investigation remontait à plus de trente ans, sous la direction du médecin hygiéniste Louis-René Villermé dans son célèbre « Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de laine et de coton ». Entre les deux, malgré ou à cause du « progrès », la situation des ouvrières s’est considérablement détériorée, même si, déjà, elles semblent plus résistantes que les hommes : en 1857, les femmes accumulent en moyenne 14 jours d’absence sur l’année, contre 18 pour les hommes.
Comme Victorine B., et avant elle, Villermé observe (en 1840) qu’il « n’est pas rare que lorsqu’une jeune ouvrière quitte son travail le soir avant l’heure de la sortie générale, on dit qu’elle va faire son cinquième quart de la journée ». À la même époque, un autre médecin hygiéniste Alexandre Parent-Duchâtelet dresse un état des lieux précis de la prostitution à Paris : 99% d’entre elles sont d’anciennes ou toujours ouvrières.
En ces décennies qui précèdent la révolution communarde, le couple chrétien infernal, prostituée ou religieuse, augmentée de la travailleuse, façonne autant les esprits que la réalité. Les ouvrières ne subissent pas seulement la concurrence de la machine mais celle des couvents, pourvoyeurs de main d’œuvre à très bon marché. (On avait même assisté, en 1834, à des émeutes contre les couvents, du côté de Lyon.)
En fin de compte, les trois décennies qui précèdent la Commune sont considérées comme les plus sinistres de la condition féminine [3].
2 – Que faire ?
Le début d’organisation du travail, la répression politique des débuts du Second Empire, sans compter le machisme qui traverse les socialistes, laissent bien peu d’interstices pour le développement d’une action des femmes. Mais paradoxalement, c’est contre la chape de plomb policière, contre la nouvelle aliénation découlant de l’industrialisation, contre les préjugés des compagnons, qu’un nouveau féminisme va s’épanouir. D’autant plus que grâce à l’exil, consécutif à l’impossibilité d’agir, les idées et les personnes circulent à travers l’Europe et plus loin encore. Dans la décennie qui précède la Commune, nombre de Français(es) confrontent leurs idées, leurs itinéraires à ceux d’autres contestataires rencontrés à Genève, Londres ou Bruxelles, en particulier des Russes en rupture avec l’absolutisme tsariste (ou paternel), dont de nombreuses jeunes femmes, issu de la noblesse de terre appauvrie par l’abolition du servage (1861), et imprégnés des écrits de Nicolaï Gavrilievitch Tchernychevsy. Dans son célèbre roman « Que faire ? » (1864), le penseur russe a placé les femmes au cœur de l’émancipation universelle, autour de la figure utopique du triangle amoureux, une femme et deux hommes : économie, liberté, créativité, égalité découleront de cette organisation géométrique parfaite. Munies de cette profession de foi, ces jeunes femmes tenteront de convertir leurs camarades occidentaux : sous l’impulsion d’Élisabeth Dmitrieff, et avant la Commune, Benoît Malon traduira le livre en français. (Outre Élisabeth, les sœurs Korvine-Krukovskaja joueront un rôle non négligeable à Paris durant le printemps 1871.)

En France, les pionnières du combat des femmes sortent d’abord des rangs de la petite bourgeoisie (André Léo, Paule Minck ou Louise Michel) ou de l’aristocratie ouvrière (Nathalie Le Mel, Victorine B. ou avant elles, Suzanne Voilquin). Engagées dans l’Internationale socialiste (ou dans des coopératives affiliées) comme leurs aînées avaient rejoint les rangs du saint-simonisme, elles se battent non seulement contre le pouvoir en place, mais aussi contre… leurs hommes et Proudhon.
Pour le théoricien dont s’inspirent les socialistes français, « la femme est inférieure à l’homme par la conscience autant que par la puissance intellectuelle et la force musculaire. (…) Elle est à l’homme comme 3x3x3 est à 2x2x2 soit 27 à 8 ». Selon le maître à penser, ce triple handicap ne peut trouver à se rééquilibrer que dans le mariage monogame [4].
Pour contrer cette pensée, alors dominante, des femmes, « bourgeoises », se lancent dans la bataille, Jenny d’Héricourt, collaboratrice à la « Revue philosophique » et Juliette Lambert, « salonneuse ». La première publie en 1860 « La femme affranchie » en réponse directe à Proudhon, tandis que la deuxième sortira l’année suivante « Les idées anti-proudhoniennes ». Jenny d’Héricourt lui lance même une mise en garde :
« Écoutez-moi bien M. Proudhon, la femme est comme le peuple, elle ne veut plus de vos révolutions qui nous déciment au profit de quelques ambitieux bavards. Nous vous déclarons que nous considérons désormais comme ennemis du progrès et de la Révolution quiconque s’élèvera contre notre légitime revendication, tandis que nous rangerons parmi les amis du progrès et de la Révolution ceux qui se prononceront pour notre émancipation civile, fut-ce nos adversaires. »
Dans les décennies précédentes, Saint-Simon ou Fourier avaient prétendu placer « la » femme au cœur de leurs utopies. L’échec des tentatives de mise en pratique de leurs projets tient dans le singulier « la femme ». L’idéalisation en « déesse mère », en être imaginaire doté d’une sexualité toute puissante, aboutit à un autre enfermement à rebours (dont témoigne Suzanne Voilquin), très douloureux pour les femmes qui l’expérimentèrent.
Les chemins pour sortir de ces clichés restent rares et escarpés : écrire, éduquer et s’éduquer, soigner, militer, agir, ou encore vivre, tout simplement, hors des conventions sociales et familiales. Celles qui s’engagent sur l’une, l’autre, ou parfois plusieurs voies s’y écorcheront souvent le corps et l’âme.
À l’instar de leur célèbre aînée George Sand, André Léo et Paule Minck sont de celles qui tendent à transformer le monde par l’écriture, pas seulement sur les femmes, et pas seulement dans les journaux. Les romans ou les articles d’André Léo (pseudonyme composé des prénoms de ses fils) restent des fulgurances, aussi bien par leur style que sur le fond, qu’ils évoquent le despotisme masculin ou la lutte des classes [5]. Paule Minck, aussi bonne oratrice qu’éditorialiste, vilipende avec ardeur le capitalisme ou l’Empire, penche pour Bakounine et développe l’idée que la femme est par excellence « un agent révolutionnaire ». L’une et l’autre auront créé des journaux, adhéré à l’Association internationale des travailleurs, tenté une vie privée non conformiste ; mais l’une et l’autre auront affronté les despotismes, le policier aussi bien que celui de leurs compagnons ou camarades [6].
Sur le terrain même, Victorine Brocher, la piqueuse ou Nathalie Le Mel, la relieuse, s’engagent dans l’action via la création de sociétés coopératives destinées à offrir du travail aux unes ou subvenir aux besoins de première nécessité des autres : une boulangerie autogérée pour la première (en 1867) et la « Ménagère » ou la fameuse « Marmite » (avec Eugène Varlin en 1868) pour la deuxième. Projets beaux et fragiles à la merci des chaos climatiques ou économiques.
Mais comment s’émanciper sans éducation ? En matière d’instruction ou de formation des filles, tout ou presque reste, alors, à inventer. Guizot, en 1833, était ministre de l’Instruction publique et avait rendu l’école obligatoire, mais seulement pour les garçons. Quelque 15 ans plus tard, le très réactionnaire comte Frédéric Alfred de Falloux impose pourtant des écoles de filles dans les communes de plus de 800 habitants. Il faudra attendre encore quinze ans pour que la mesure soit étendue aux communes plus petites et encore très nombreuses, mais sans que celles-là aient les moyens d’en ouvrir ou de les maintenir. Par ailleurs, les institutrices « publiques » constituent une sorte de prolétariat intellectuel puisque la plupart gagnent moins qu’une bonne. Du coup, et pour longtemps encore, cet enseignement reste sous le contrôle de l’Église, via la place prépondérante des institutrices membres de congrégations religieuses. Et en 1867, 41 % des femmes ne savent toujours pas signer de leur nom, lors de leur mariage (tandis que 75 % des hommes peuvent le faire).
Malgré ce retard, lorsqu’en 1867 Victor Duruy instaure des cours d’études secondaires pour jeunes filles, le succès est immédiat. Il leur ouvrira également l’université, mais comme ailleurs en Europe, au seul secteur médical, et encore sans le droit de pratiquer en métropole (les diplômées iront exercer leurs talents en Algérie ou en Turquie…). Cela dit cette obligation, la médecine, est souvent choisie par les étudiantes – la nécessité seule ne fait pas loi. Par culture, éducation familiale, voire piété qui ne dit pas son nom, l’idée de soigner s’impose comme engagement personnel, un moyen « d’aller au peuple », comme les parcours de la populiste russe Sophia Perovskaïa ou de la Française Suzanne Voilquin le donnent à penser. Il faut de la personnalité, un fort entêtement, des dons certains, et une aide extérieure (masculine), pour réussir alors, comme Sophia Kovalevskaïa à devenir « l’un des grands mathématiciens » de son temps.

Quant à la formation professionnelle, elle reste une espérance lointaine : comme on l’a vu, des ouvrières très qualifiées dans le textile rétrogradent à leur arrivée en usine, faute d’apprentissage sur les nouvelles machines.

Pour peupler ce « no man’s land » éducatif, certaines comme Louise Michel projettent d’ouvrir des internats pour filles modestes, orphelines, paysannes ou prolétaires. D’autres choisissent un chemin plus individuel. En 1861, Julie Daubié, après plusieurs tentatives, devient la première bachelière… Elle avait déjà été couronnée par un prix en 1859 avec une étude sur « Les moyens d’élever le salaire des femmes à l’égal de celui des hommes, lorsqu’il y a égalité de travail et d’ouvrir aux femmes de nouvelles carrières ». Et elle fut la première licenciée en lettres à la Sorbonne.
À la veille de la Commune, fortes de leurs combats, de leurs déceptions comme de leurs réussites, attisées par l’amertume des mois de guerre et de misère, les femmes sont mûres pour investir tous les champs qui leur étaient interdits ou restreints. Après des décennies de régression et de répression, elles sont prêtes à guerroyer ferme pour mettre en pratique leurs revendications. Pourtant, pendant longtemps, beaucoup de leurs aspirations resteront à l’état de mots. Et il leur faudra oser, inventer, défricher d’autres espaces : l’amour, la réappropriation des corps, les arts tels la peinture ou la sculpture, elles qui s’étaient jusque-là seulement aventurées en poésie. La bataille ne fait que commencer, pour en finir avec ce statut de « prolétaires des prolétaires » - 70 ans encore à attendre le droit de voter - elle est loin d’être achevée…
Sylvie Braibant
Notes
[1]Suzanne Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple, Introduction de Lydia Elhadad, Maspero, Paris, 1978.
[2] Victorine B., Souvenirs d’une morte vivante, Maspero, Paris, 1976
[3] Maïté Albistur et Daniel Armogathe, Histoire du féminisme français, Ed des Femmes, Paris, 1977
[4] On remarquera que Proudhon trempait sa plume non seulement dans la misogynie mais puisait également à l’antisémitisme. Ce double rejet, très chrétien, des femmes et des Juifs était également à l’œuvre chez Bakounine.
[5] Sur André Léo, voir l’excellente biographie de Alain Dalotel, André Léo, 1824-1900, La Junon de la Commune, Ed Cahiers du pays chauvinois, Chauvigny, 2004 (en vente au siège) ; et sur Paule Minck, du même auteur, Paule Minck, communarde et féministe, Ed Syros, Paris, 1981.
[6] Comme ces Françaises, à la même époque, les jeunes activistes russes (qu’on retrouvera durant la Commune), en rupture avec le Tsar et leurs pères, écrivaient à Genève des programmes pour réorganiser le travail, des femmes ou des hommes, en ateliers coopératifs inspirés des communautés paysannes de l’ancienne Russie. Elles feront elles aussi l’expérience des désillusions publiques et privées.