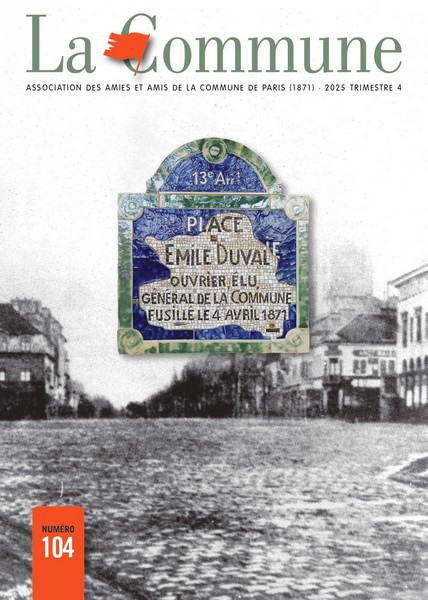Dans L’Intransigeant du 5 février 1882 fut insérée une « touchante lettre de faire-part » :
Citoyens, vous êtes priés d’assister à l’enterrement civil du citoyen Charles Mabille, ancien combattant de 1830, détenu politique sous Louis-Philippe, sous la République, sous l’Empire, déporté de 1871 à la Nouvelle-Calédonie, décédé à l’âge de 74 ans, à l’hospice de Bicêtre. »

Il n’avait pas atteint cet âge, puisque Jean-Charles Mabile, qui signait « Mabille », était né à Bazailles, en Meurthe-et-Moselle, le 20 décembre 1812. Contrairement à ce qu’a pu écrire Louise Michel, il ne fut pas le « plus vieux des déportés de 1871 ». En Nouvelle-Calédonie, ses aînés étaient au moins au nombre de 25, et le titre de doyen revient probablement à Charles Contal, né en 1806, jugé « indigne d’indulgence, malgré son âge ». Dans la seule presqu’île Ducos, les vétérans étaient Maurice Taillefer et Jean-Marie Dargent, qui avaient vu le jour, respectivement, le 15 juillet et le 12 septembre 1812. Toutefois, le « père Mabille » était connu, parmi les exilés des antipodes, comme « un vétéran de la démocratie militante », selon le témoignage de son ami Louis Redon.
Dans L’Insurgé, Vallès contribua à forger sa légende :
Le père Mabille est un ancien ciseleur qui a perdu le tour de main de son état dans l’oisiveté cruelle de la détention, et qui s’est fait marchand de rues. Mais, pendant les années de prison, il a étudié dans des bouquins empruntés à ses voisins de travée ; il a réfléchi, discuté, conclu. Son grand front ridé et dégarni raconte ses méditations ; ce vendeur d’éventails ou d’abat-jour – suivant la saison – a la face d’un philosophe de combat, haut vieillard et l’on saluerait sa tête grave :
- Qu’enseigne-t-il ? demandaient les gens de la Sorbonne ou de la Normale.
Ce qu’il enseigne ? Sa chaire est ambulante comme sa vie ; elle est faite de la table sur laquelle il s’accoude, dans un cabaret pauvre, pour prêcher la révolte aux jeunes, ou d’un tonneau enlevé à la barricade et mis debout, pour qu’il y monte et harangue de là les insurgés.
Ce sont les sommiers judiciaires [1] qui nous permettent de retracer l’itinéraire d’« un vieux blanquiste qui fit de la politique ses moyens d’existence », selon le rapport du commissaire du gouvernement en 1878. Arrêté « au moment où il travaillait à la construction d’une barricade », durant l’insurrection de juin 1848, il fut condamné à dix ans de détention à Belle-Île. Après sa libération, il se retira au Havre, où il fit 15 jours de prison pour vol ou recel, en avril 1863, et subit une amende de 25 francs pour outrage envers des agents de la force publique, en avril 1864. En avril 1870, il fut incarcéré pendant un mois à Mazas pour affiliation à des sociétés secrètes, et, lors de la perquisition faite à son domicile,
on découvrit un portrait de Blanqui, des brouillons de lettres à Raspail et autres personnages politiques.
Selon le témoignage de Louis Redon, qui fut son confident entre février et juillet 1875, au dépôt de Saint-Brieuc, puis à bord du Var, il aurait été arrêté, en fait, à treize reprises, « chaque fois qu’une apparence de mouvement se dessinait ». Au fil de leurs entretiens, son compagnon nous apprend qu’« il n’avait reçu aucune instruction », et que c’est Blanqui, dont il partagea la captivité à Belle-Île, qui en avait :
fait un homme supérieur. Il connaît d’une façon remarquable l’histoire, aussi bien l’histoire ancienne que notre grande histoire révolutionnaire. Il est doué d’une grande puissance d’assimilation. Blanqui a pétri cet homme comme il faudrait que notre génération soit pétrie. On ne peut nier le génie de celui que nous appelions tous ”le Vieux“ lorsqu’on a vu cette manifestation de la puissance de son esprit. […] Entier comme le maître, il est d’une dignité parfaite.
Ses agissements durant la Commune restent obscurs. On a peine à croire que, « sachant à peine lire et écrire », il se soit montré « incapable d’exercer les fonctions de commissaire [de police du quartier de la Chaussée d’Antin] qui lui furent retirées au bout de fort peu de temps ». En fait, Redon devinait que ce « vieux lutteur savait se transporter en temps utile aux endroits où le besoin d’hommes intelligents et dévoués se faisait sentir. Qu’a-t-il fait ? Le conseil de guerre n’en a pas eu le premier mot. » On sait que nombreux furent les blanquistes qui investirent l’appareil policier de la Commune.
Curieusement, après avoir été le bénéficiaire d’un non-lieu pour vol, en septembre 1872, il quitta la France pour se réfugier en Angleterre, avant de revenir en région parisienne, un mois plus tard ! Se sachant recherché, cet « homme dangereux » avait quitté furtivement, en novembre 1873, le « taudis », qu’il louait sous le nom de Rousseaux, et il aurait vendu des articles de ménage pour le compte d’un quincailler. Après une enquête infructueuse menée au Havre, en septembre 1874, « chez tous les logeurs en garni, dans tous les hôtels, chez tous les aubergistes et dans tous les quartiers », il fut arrêté, le 10 novembre 1874, à son nouveau domicile parisien, rue Asselin n° 7, où il « vivait dans la plus profonde misère, en concubinage avec une femme de mauvaises mœurs ».
Selon l’enquête de police, « on ignore ce qu’il a fait pendant les derniers jours de la lutte », mais, « avec ses antécédents politiques, il est à présumer qu’il a combattu. » Aussi fut-il condamné, le 7 décembre 1874, par le 3e conseil de guerre, à la déportation en enceinte fortifiée, moins en sa qualité d’ex-commissaire de police qu’en tant que révolutionnaire professionnel. Louis Redon, qui mourut à l’hôpital de l’île des Pins le 6 avril 1876, et lui furent séparés en rade de Nouméa, « le 6 thermidor an 83 ». Mabille rejoignit la presqu’île Ducos, où séjournait Louise Michel, qui l’évoque dans un volume de ses mémoires :
Sa haute taille s’était courbée [il mesurait 1,75 m] ; parfois, quand on le voyait passer par les sentiers des montagnes tremblant sur ses grandes jambes maigres dont le pantalon de toile blanche dessinait les os, on eût dit que le moindre vent le jetterait comme une feuille sèche. Il […] avait travaillé dans sa rude vie comme homme d’action et comme propagandiste. Nul ne vécut plus froidement et ne subit plus fièrement les condamnations de tous les gouvernements sous lesquels il vécut. Avec quel entrain, quelle verve révolutionnaire, il racontait les vieilles et nouvelles histoires du despotisme éternel.
Toutefois, Mabille jugeait avec sévérité les « blindés » qu’il devait côtoyer :
La situation morale est des plus mauvaises, non pas par le fait de l’administration qui nous laisse libre de faire ce que nous voulons, mais je n’ai jamais vu une réunion d’hommes si pauvres ; beaucoup ne savent pas lire ; ils parlent argot ; ils ne rêvent que de vin ; ils se saoulent, ils se battent, ils se tuent ,
écrivait-il en février 1876 dans une lettre retenue par l’administration. Il ne se montrait pas plus indulgent à l’égard de ceux qui purgeaient leur peine à l’île des Pins, ne s’alarmant pas qu’un conseil de guerre y
fonctionne avec sévérité ; ce n’est pas un malheur pour maintenir cette série d’hommes qui font la honte et le malheur de la déportation.
Des Internationalistes (Nathalie Le Mel, Charbonneau, Danière, Delacour, Malzieux…) s’émurent que nombre de blanquistes eussent sollicité la grâce du maréchal-président, mais Mabille, lui, s’y refusa. Il dut attendre mai 1879 pour bénéficier d’une remise de peine et fut rapatrié par La Loire, qui débarqua 295 déportés à Brest, en mars 1880. L’attitude à leur égard du commandant Ducrest de Villeneuve, beau-frère de Jules Verne, fit l’objet de plaintes après qu’il eut infligé une punition à Mabille « pour inconvenance envers un aide-médecin ».
Selon le Radical, il se serait suicidé, « faute de pouvoir trouver du travail » ; en fait, il serait devenu peintre en bâtiment à son retour, et un rapport de police de février 1881 le désigne comme « un ardent propagateur auprès des jeunes ouvriers » des théories révolutionnaires. C’est « après une longue et douloureuse maladie », qu’il mourut, le 30 janvier 1882, âgé de 69 ans, à l’« hospice de vieillesse » de Gentilly, qui fut aussi le dernier refuge du colonel Chabert. « Empêchée par une grave indisposition d’assister à la funèbre cérémonie », la citoyenne Louise Michel chargea Champy, qui fut membre de la Commune, de « saluer pour la dernière fois le brave combattant sur la brèche depuis 1830 », et l’« on se sépara aux cris de :
Vive la Commune ! Vive la Révolution sociale !
YANNICK LAGEAT
Sources
• (A.N., BB/24/848 ; A.P.P.P., BA 1086 (Frankel) ; S.H.D., Justice, 3e conseil, n° 1940 ; SHD, Marine, CC3 carton 2180.
• Louise Michel, À travers la mort. Mémoires inédits, 1886-1890, La Découverte, Paris, 2015, 353 p.
• Redon L., Les Galères de la République, Presses du CNRS, Paris, 1990, 273 p.
• Vallès J., L’Insurgé (préface, commentaires, notes de R. Bellet). Les Classiques de poche, Paris, 1972, 384 p.