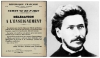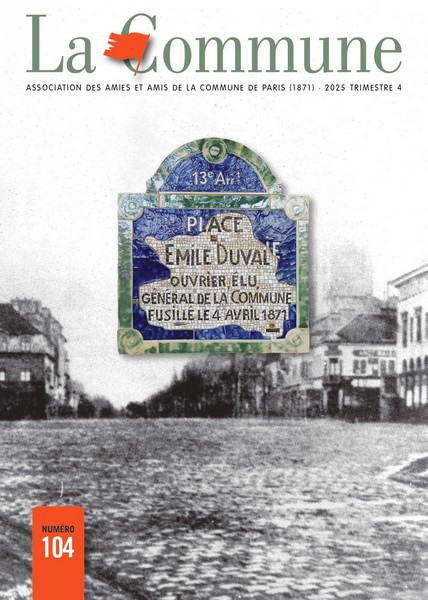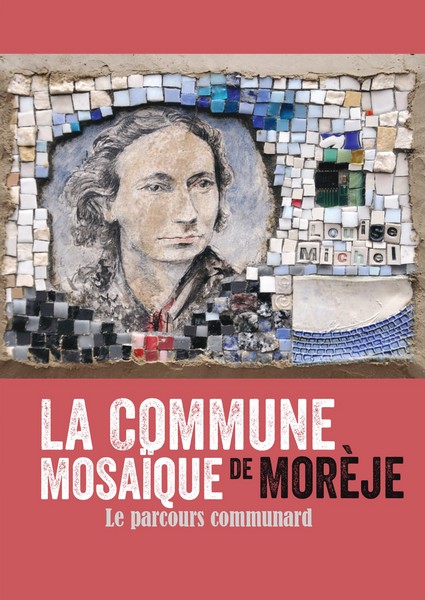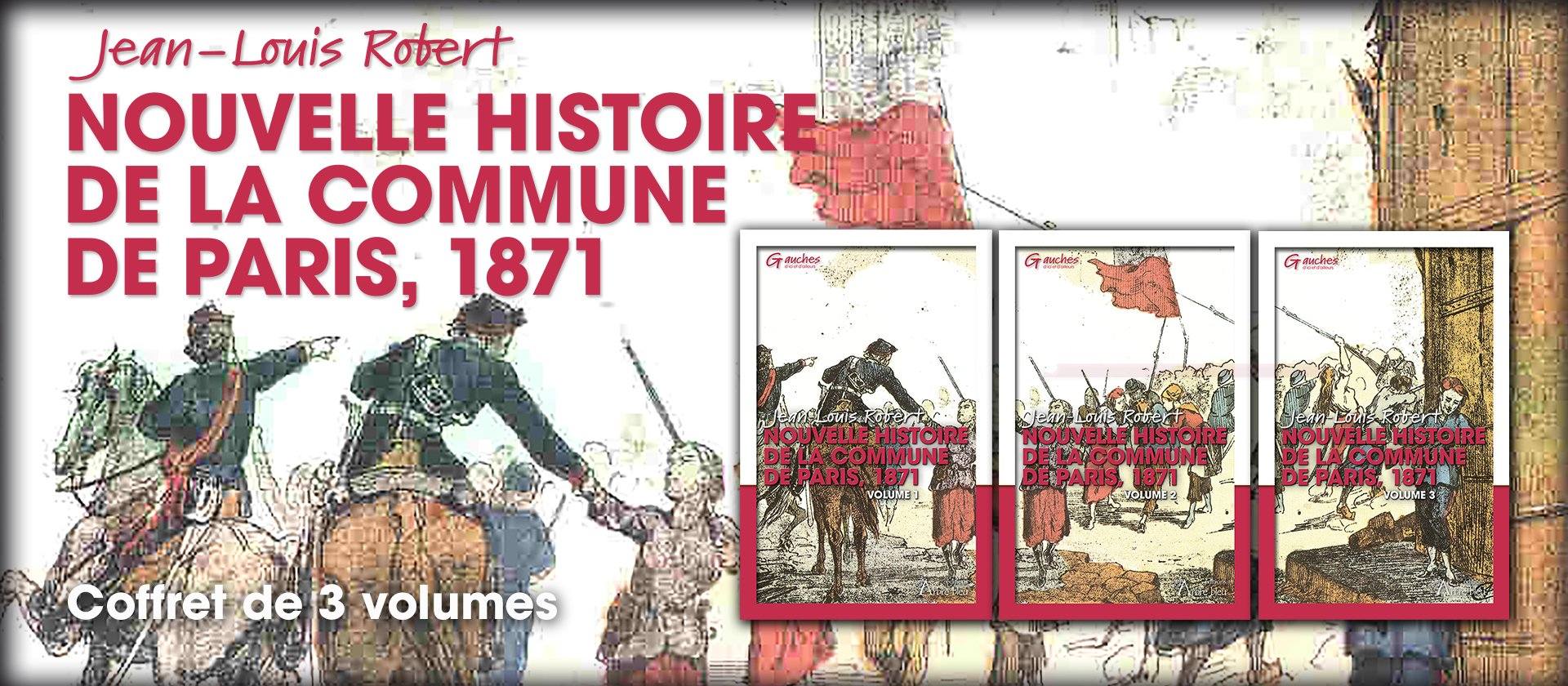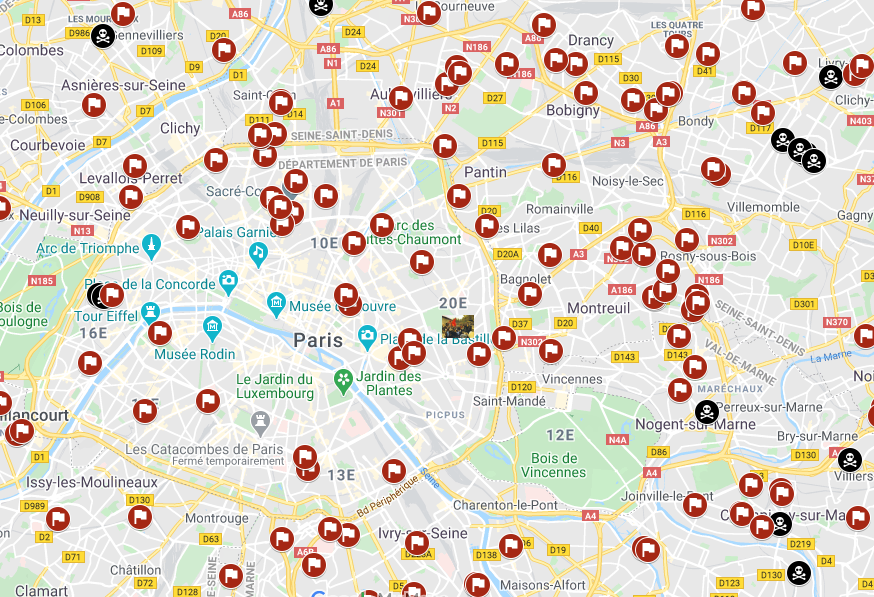NOUVELLES CALÉDONIES, DU TEMPS DES CERISES AU TEMPS DES LETCHIS
Nouvelles Calédonies, Du Temps des cerises au Temps des letchis, éditions Maïa, 2024

Tout commence par des souvenirs d’enfance, des non-dits, des chuchotements, des secrets, des questions sans réponse :
« Tu es trop petite pour comprendre ».
Sauf le grand-père maternel (le rouge de la famille par ailleurs bourgeoise et royaliste) qui en disait un peu plus.
Mais tôt ou tard, comme dans beaucoup de familles, ces souvenirs ressurgissent. Pour Marie-Hélène Lafouge, l’autrice du livre Nouvelles Calédonies..., ce fut un certain 18 mars.
Alors, elle se lance dans des recherches, écume les états-civils, et finit par trouver que du côté de sa grand-mère, un ancêtre communard a été déporté en janvier 1873. Elle s’aperçoit également que du côté de son grand-père, ses aïeux ont également connu le bagne et sont morts à Nouméa.
Après cinq ans de recherches et d'écriture, elle vient de publier, aux éditions Maïa, son premier roman.
Cet ouvrage est l'histoire de sa famille, celle d'aïeux ayant été déportés en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle. Marie-Hélène Lafouge raconte d’une plume alerte et avec plein de détails émouvants, le passé de ses aînés au sein de cette terre lointaine, colonie française.
Mais, dit-elle,
J'ai voulu raconter leur histoire mais sous le prisme féminin de leurs épouses qui les ont suivis dans leur déportation : Alexise Lechesne, Marie Gartner, Victorine Sauvan.
Aussi, c’est seulement à partir de la page 79 que l’autrice commence à décrire l’histoire d’Eugène Hilaire Jacques Pérault, son aïeul, communard né à Niort et condamné le 19 juillet 1872 à la déportation simple.
De sa vie en prison à son transport vers la Nouvelle-Calédonie, de sa survie avec sa compagne Alexise, avec qui il se marie là-bas, à l’amnistie longtemps espérée, de son décès en août 1876 à Nouméa au retour d’Alexise à Brest en juillet 1877, l’auteure nous décrit par le détail cette vie extraordinaire mais épouvantable.
Redécouvrir l’histoire hélas longtemps passée sous silence de ces milliers de déportés à travers des histoires personnelles, c’est tout le mérite de cet ouvrage que j’invite chacune et chacun à découvrir.
DENIS ORJOL
COMITÉ TRÉGOR-ARGOAT
Marie-Hélène Lafouge est professeure d’anglais retraitée. Elle vit à Vannes et est membre de notre comité.
UNE LEÇON D’HISTOIRE POLITIQUE
Les Seigneurs de Paname, Noël Carle, Ed. Maïa, 2024
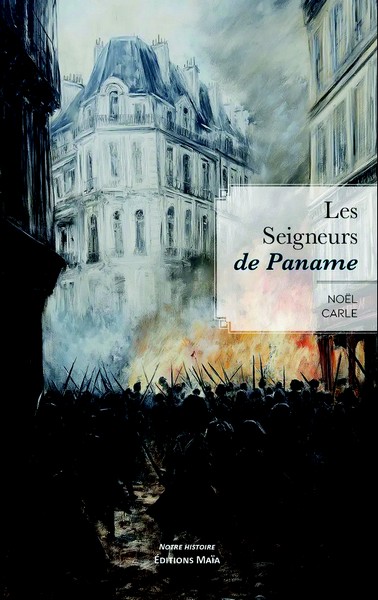
Comme nous pouvons fréquemment le constater, les romans facilitent la transmission de valeurs, d’idées, d’engagements, pour peu que leurs auteurs donnent du corps aux évènements, aux femmes, aux hommes qui les vivent. Il en est ainsi du livre Les Seigneurs de Paname de Noël Carle, publié aux éditions Maïa en 2024. En couverture, une rue, il fait sombre même si une lueur éclaire le fond. Des baïonnettes, un combat, le feu et les fumées. Des scènes de ce type, Paris, « Paname », en a connues quantité dans ce 19e siècle riche en révolutions. Le lecteur se retrouve en plein siège de Paris dans l’hiver 1870, un des plus froids. Un rat est tué par des chasseurs de rats. Rappelons-nous le célèbre tableau Le dépeceur de rats de Narcisse Chaillou. Nous vivons les bombardements et les dialogues d’un triste immeuble de la rue Hautefeuille prennent un sel particulier par l’usage de l’argot parigot. C’est toute une communauté, haute en couleur qui cherche à survivre. Que mange-t-on ? Du cheval, du pigeon, du chien, du chat, du rat. La faim, le froid, les enfants mourant, déposés à la fosse commune à Montparnasse.
Et puis une affiche rouge
Une affiche rouge sur les murs de Paris annonce les évènements que nos lecteurs connaissent bien. Les atermoiements des républicains plus que modérés, Simon, Ferry, Favre sont en parallèle avec les offensives lamentablement menées par Trochu, le massacre de Buzenval, les tirs des Prussiens depuis les hauteurs de Clamart. Nous vivons ces scènes grâce au talent de Noël Carle, tout cela est bien mené et retient notre attention. Nous sommes le 22 janvier, place de l’Hôtel de ville, le 18 mars à Montmartre. Nous vivons les scènes grâce aux personnages du roman, leur vie quotidienne, leurs sentiments, leurs rêves, leurs angoisses dans les combats. C’est une forme de roman initiatique pour les protagonistes et pour le lecteur, une leçon d’histoire politique. Le portrait de Thiers est particulièrement réussi, traduisant bien le côté abject du personnage. Mais, « ils sont rentrés dans Paris », occupent le 15e et le 16e arrondissements parisiens. Ils avancent inexorablement et tuent, massacrent, violent. Vous êtes dans les rues avec Lucien Combatz, le Piémontais garibaldien et ses amis de la rue Hautefeuille. Jour par jour, vous sentez grandir ces personnages jusqu’à ce 28 mai 1871. Et après ? Après, c’est un roman et je laisse le soin de le goûter.
FRANCIS PIAN
LE GRAND FINAL
Le grand final, Krill&Zon, Édition à compte d’auteur, 2025

Écrit à quatre mains, déjà paru en Italie, ce livre est un roman ou plutôt une fable, tel qu’il se définit lui-même au fil des pages. Une fable à suspense…
Il met en scène un assortiment de personnages « à la Pennac », pourrait-on dire, de genre, d’âge et de milieux très différents, mais partageant presque tous un vécu plutôt en marge, volontairement ou non. Au fil des rencontres, ils se retrouvent à imaginer, puis à organiser un événement extraordinaire, vraiment extraordinaire, pour l’anniversaire des 150 ans de la Commune, un véritable assaut du ciel.
On est très loin ici de l’étude historique, on n’apprend pas grand-chose sur le déroulement de ses 72 jours. C’est l’histoire imaginaire d’une reconquête de la mémoire, le rêve d’une revanche bien méritée.
De quoi la Commune est-elle encore le symbole, un siècle et demi plus tard ? Des vieux militants vaincus, s’accrochant à leurs interprétations politiques, jusqu’aux plus jeunes, grandis et survivant dans un autre monde, maîtrisant d’autres moyens d’expression ou de lutte contre le système, chacun est - ou se découvre - à sa façon, héritier de la Commune. Et c’est l’action qui les réunit.
Les portraits sont bien campés (on y croise même Françoise Bazire, notre ancienne secrétaire générale !), c’est un récit plein de tendresse, de facétie, de clins d’œil, d’optimisme, qui fait du bien par les temps qui courent. On jubile à voir l’ingéniosité de « ceux qui ne sont rien », mais sont partout, mettre en échec tous les vilains.
L’écriture emprunte au polar, le langage est moderne, familier. On sent l’intention de s’adresser à tous. Sauf bien sûr à ceux qui rechigneraient devant un genre jugé sympathique, mais trop léger, pas assez sérieux.
Certes, quoique… « Mettre toutes nos forces en commun », n’est-il pas ce qu’il y aurait de plus sérieux à faire, justement ?
VALÉRIE MARTINEAU
Pour en savoir un peu plus, découvrir les auteurs, leurs projets, commander le livre, leur site : www.krillandzon.org
Vous le trouverez aussi le 24 mai place des Fêtes, avant la montée au mur.
CONTER POUR APPRENDRE
La Commune de Malenpis, André Léo, Ed. Le temps des cerises, 2021
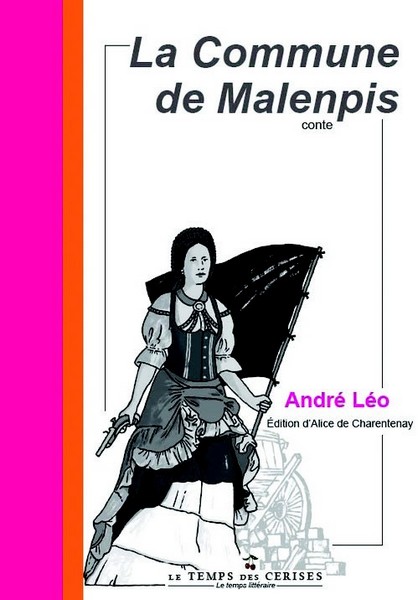
Nous connaissons les écrits politiques d’André Léo, tant lors de la Commune de Paris que pendant son exil et son retour en France. Elle y défend les droits des femmes et la construction d’une société socialiste. Ses contes sont beaucoup moins diffusés. Et c’est un plaisir de retrouver l’un d’entre eux, La Commune de Malenpis accompagné d’une préface d’Alice de Charentenay, publié aux éditions Le temps des cerises. En décembre 1873, La République française, le quotidien de Léon Gambetta présente ce conte en feuilleton repris rapidement en volume. Selon sa préfacière, cet ouvrage échappe au risque d’être une réécriture de la Commune historique, il n’empêche que nombre de réflexions, de scènes, de personnages font écho à cet évènement. La presse aime ces feuilletons, textes courts qui fidélisent le lecteur. Pour André Léo, il s’agit d’analyser l’esprit des gens, les conséquences de l’économie de marché, de valoriser ses idées libertaires dans une langue travaillée, tantôt amusante, tantôt moralisatrice.
Dans la cité de Bien-Heureuse, il n’y a pas de roi, les institutions régaliennes comme la justice, les impôts, la police, l’armée sont quasiment inexistantes. Le Conseil municipal, non exempt de défauts, n’a guère de pouvoirs autonomes. « Vous n’êtes conseiller que par l’élection du peuple », la Commune de Paris n’est pas loin. L’enseignement auprès des enfants mêle l’esprit et le manuel. Encore un écho communard. Tout va pour le mieux ? Pourtant, la simplicité de la vie campagnarde, rappelons-nous les origines poitevines d’André Léo, est fascinée par le luxe de la Cour du royaume tout proche. Sa description n’est pas sans rappeler les fantaisies d’Offenbach avec le général Rrran de Craquen-boum et le roi Bombance. Les gens sont fascinés par le pouvoir et ils demandent à intégrer le royaume. Celui-ci se révèle : la hausse des impôts, l’enrôlement des jeunes et la guerre, le contrôle des contestataires, la censure. Tiens Napoléon le Petit n’est pas loin dans la confusion des combats.
Et comme c’est un conte, tout s’arrange à la fin. Morale de l’histoire :
Après tout ce qui s’est passé, après avoir vu les rois et princes amener avec eux les mauvaises moeurs, le vol et la guerre, il n’est personne maintenant à Bien-Heureuse qui ne sache que la vraie richesse est dans le travail, et que le bonheur et l’ordre véritable ne sont pas ailleurs que dans la liberté.
FRANCIS PIAN