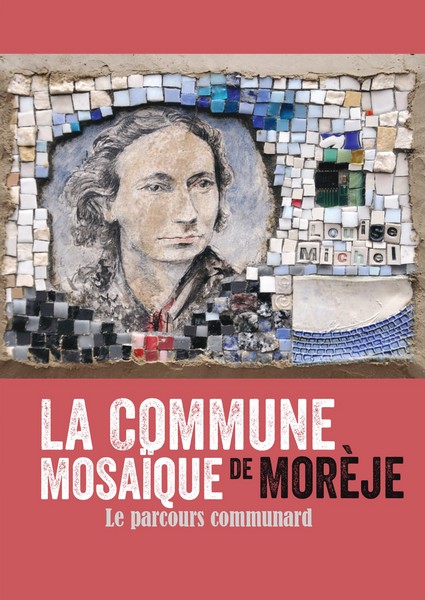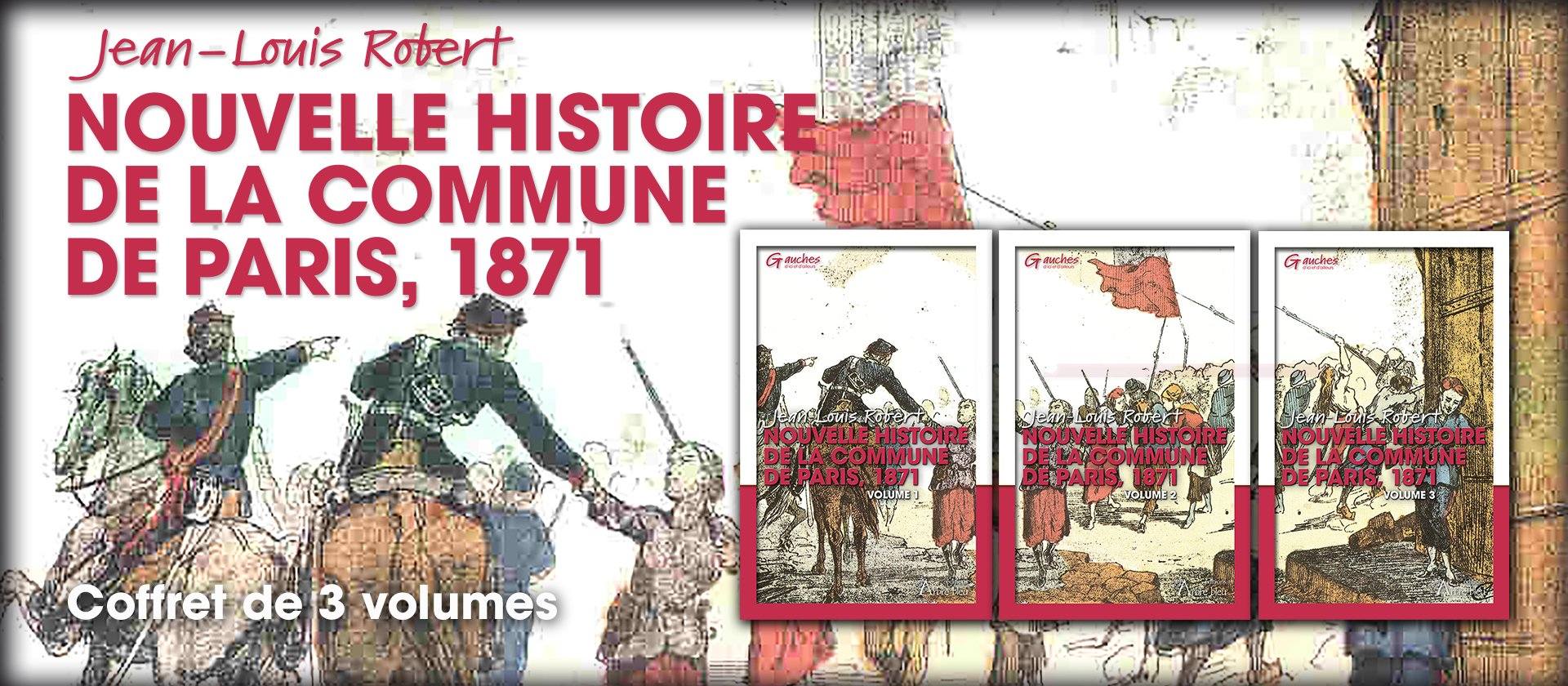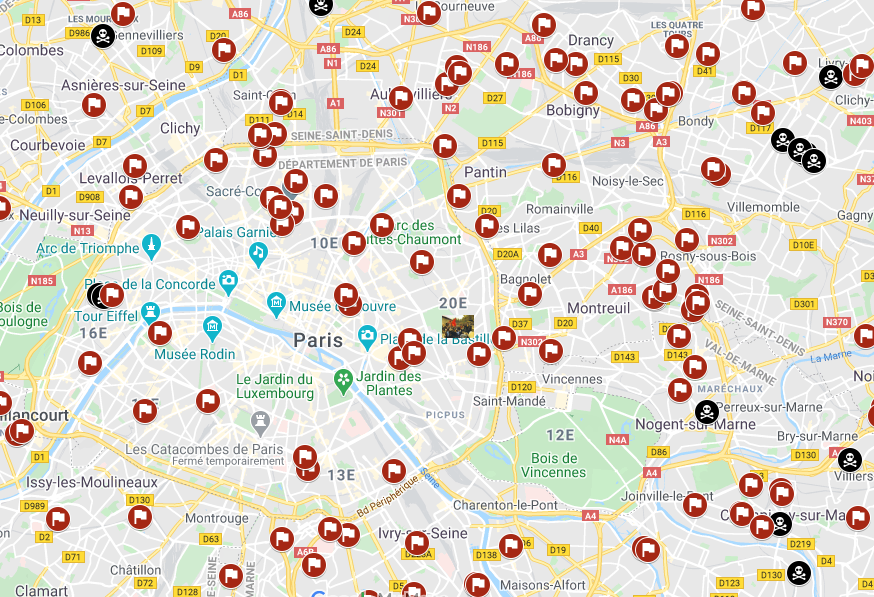PARIS, CAPITALE D'UN EMPIRE COLONIAL
Paris capitale d'un empire colonial, Sur les traces du colonialisme..., Pascal Varejka et Marinette Delanné, Éditions du Petit Pavé, 2024.
Un livre d'histoire et de pédagogie, avec une documentation impressionnante, tel est le projet de l'essai de Pascal Varejka et Marinette Delanné sur le passé colonial de Paris. Un programme ambitieux, à n'en pas douter, à la mesure des méconnaissances et des oublis qui entourent cette période.
Ce que statues, monuments et édifices nous disent du passé colonial de la France résonne avec une époque de conquêtes, exactions, brutalités et exploitations soumises à un projet impérial et impérialiste que les deux expositions coloniales de 1907 et 1931 font principalement affleurer. L'héritage de la violence coloniale possède une haute signification et c'est bien ce que ce livre nous rappelle avec une extrême rigueur.
Des fresques du palais de la Porte Dorée aux noms de rues et statues, la charge d'histoire est forte qui révèle, dans le marbre et la statuaire, le rôle terrible des compagnies coloniales et de la traite négrière. Ainsi se livrent dans ce parcours inédit, et photos à l'appui, les stratégies répressives de l'occupant (menaces, emprisonnements et propagande) qui exposent méthodiquement les voies multiples de l'indignité et de l'injustice. À cet égard les auteurs mettent bien en exergue une imagerie (idyllique) des produits coloniaux et du commerce international se déployant sur les murs de Paris comme un rappel vestigial de l'esclavage et d'une administration fièrement pénitentiaire.
Ce livre est un récit, donc, ponctué de références historiques, de lois et de décrets, qui imprègne notre histoire, une histoire contemporaine, une histoire qui ne passe pas.
En contrepoint, et c'est une force de cette relation funeste, hommages sont rendus aux mouvements de libération et de résistance, aux héros de la décolonisation et de l'abolition de l'esclavage. Citons des noms, qu'on ne cite pas si souvent : le sénégalais Lamine Senghor, l'algérien Messali Hadj ou la guadeloupéenne Rosalie dite Solitude. Et encore, plus familiers, Hô Chi Minh, Toussaint Louverture, Victor Schoelcher. Enfin ces héroïnes de la Commune, ce creuset de toutes les résistances, André Léo, Nathalie Le Mel et Louise Michel.
Un regret toutefois, certes atténué par la contraction nécessaire des options d'analyse : on notera l'absence des conventionnels de la Révolution française (précisément Robespierre sur le décret d'abolition de l'esclavage) et quelques raccourcis historiques concernant les guerres d'Indochine et d'Algérie.
Mais l'ensemble est très riche et passionnant, une leçon d'histoire, une mémoire vive et ininterrompue. C'est aussi un hommage aux vaincus, futurs vainqueurs.
JEAN-ÉRIC DOUCE
Paris capitale d'un empire colonial, Sur les traces du colonialisme..., Pascal Varejka et Marinette Delanné, Editions du Petit Pavé, 2024.
HUIT ANS À NOUMÉA
Ce titre dévoile le récit d’Albert Leblanc, communeux, ingénieur civil, membre de l’Internationale et délégué par le Comité des vingt arrondissements pour susciter des mouvements locaux. Leblanc n’est pas répertorié par Bernard Noël dans son Dictionnaire de la Commune. Le récit, parut en épisodes dans le quotidien Le Rappel (cité, lui, par B. Noël) du 5 janvier 1880 au 20 janvier 1881. Puis, plus rien… Pendant 140 ans !
Guy Blondeau redonne présence à ce récit et à son auteur. Guy Blondeau est un des animateurs du
CULTURE
29
LECTURES
Comité sarthois des Amies et Amis de la Commune. Il nous livre sa démarche de recherches, le hasard de la trouvaille de ce récit. Il explique le combat pour l’amnistie mené par Le Rappel, journal des amis de Victor Hugo. Huit ans à Nouméa 1 est signé L…, Leblanc, bien sûr. Son texte est primordial pour l’histoire de la déportation : ce n’est pas un énième récit de voyage. Il dénonce les actes odieux colonialistes primaires à l’égard des anciens insurgés, commis par l’administration, mais aussi par les corps religieux. En plus d’être un pamphlet contre l’arbitraire, il décrit la rencontre, ensuite, d’un acteur important des Communes de Lyon et du Creusot. Guy Blondeau se fait excellent avocat d’Albert Leblanc.
Ce « journal » se découvre en 16 chapitres, depuis le départ de la ville de Rochefort. Rude épopée réaliste au regard acéré. Brutalité d’un côté, solidarité et ingéniosité de l’autre. Vive aussi le drapeau du travail !
La seconde partie, par l’excellent essartage de Guy Blondeau nous fait (re)découvrir un révolutionnaire au temps de la Commune. Nous le suivons à Lyon, pour l’insurrection du 22 mars 1871 et sa rencontre avec Narcisse Barret, internationaliste, puis au Creusot, puis de retour à Lyon. Fatalitas ! C’est l’arrestation, les interrogatoires, les trois procès. Verdict : déportation en enceinte fortifiée. Voyage vers « La Nouvelle » ! Donc, Huit ans à Nouméa. Le retour à Brest, le 28 septembre 1879, n’est pas de tout repos. Le récit de Barret (Nouméa aller et retour) est publié en 23 épisodes. Puis, ce sont les 37 épisodes de Leblanc.
Guy Blondeau, merle moqueur, nous livre des cerises sur le gâteau : des annexes avec les correspondances de Leblanc, l’interrogatoire conservé aux archives du Rhône 2 et bien sûr, la date de publication des articles.
Soulignons, une fois encore que les Éditions (angevines) du Petit Pavé continuent leur travail éclairant d’éditeurs militants pour les causes historiques, progressistes et humanistes
MICHEL PINGLAUT
1) Huit ans à Nouméa, journal d’un communard déporté, présenté par Guy Blondeau, Éditions du Petit Pavé, 2 chemin du Petit Pavé, Saint-Jean des Mauvrets, 49320 Les Garennes-sur-Loire.
2) Archives du Rhône, cote R- 929.
* Albert Leblanc figure page 783 dans La Commune de Paris, ouvrage coordonné par Michel Cordillot, Éditions de l’Atelier.
LA POÈTE AUX MAINS NOIRES
Ingrid Glowacki titre ainsi son premier roman sur une des grandes artistes du XIXe siècle : Marie Talbot. Femme, paysanne, bâtarde. Céramiste ! L’autrice a eu cette révélation à La Borne, village de potiers, commune d’Henrichemont (18250) en visitant l’exposition qui fêtait l’artiste en 2024. Marie Talbot est née en 1814. On sait très peu de choses d’elle. Mais, il y a le bonheur du regard de ses oeuvres. Sa matière ? Le grès, une argile grise particulière, utilisée en Berry.
Ce roman est joliment fictionnel, avec des ossatures citationnelles. L’autrice redonne pensées, rêves, idéaux, combats, utopie mais aussi fêlures à cette femme coincée par la religion et le Code Napoléon. Avant elle, à la Borne, il n’y a pas de féminin au mot potier. C’est tout juste si les mâles créateurs leur laissaient poser, à ces « fumelles » 1, des anses sur les pots. Pour la première fois, le 9 août 1837, elle signe une fontaine en grès, avec tête de femme : « Fait par moi, Marie Talbot ». C’est son nom d’artiste, à Jeanne Brûlé, sa vraie identité. Comme Aurore Dupin signera
LECTURES
30
George Sand. C’est pourquoi Ingrid Glowacki va amener l’autrice d’Histoire de ma vie dans ce village du Haut-Berry. Fiction. Et même, présence trop exagérée, même si elle joue un rôle féministe révélateur. Notre amie Eugénie Dubreuil qui a eu l’excellente idée de placer un pot à visage féminin, modelé par Marie à l’exposition « La Musée » à Poitiers, partage notre point de vue 2.
Ce qui nous intéresse aussi, c’est qu’I. Glowacki place la mort de son fils, fusillé rue de la Fontaine-au- Roi pendant la Semaine sanglante. Nous sommes le 28 mai. Échos des fontaines en grès à la Fontaine-au-Roi. Marie meurt en 1874. Bon écho romanesque de ce livre à la puissance créatrice de Marie Talbot.
MICHEL PINGLAUT
1) fumelle : femme, en parler berrichon
2) LA MUSÉE, une autre histoire de l’art, exposition au musée de Poitiers, tenue jusqu’au 18 mai 2025
La poète aux mains noires, Éd. Gallimard/ l’Arpenteur, 192 p., septembre 2024
FIÈRE DE SES IDÉES
Joséphine Marchais, une de ces oubliées de la Commune de Paris qui se sont battues jusqu’au bout car elles savaient ce qu’elles perdaient. Francis Brunet relate, dans son livre Joséphine Marchais … De Blois à l’île du Diable, la vie de cette jeune femme qui mourra au bagne à 37 ans. Comme pour nombre d’ouvrages, l’auteur traduit cette courte vie sous forme de roman parlé. Elle raconte, Joséphine, la vie pauvre des gens du peuple à Blois, victimes des inondations de la Loire, des conditions de travail indigentes, la vie sans perspective des jeunes femmes prostituées. Profitant de la guerre de 1870, elle vient à Paris avec Céleste Hardouin, rencontre André Léo, Louise Michel, fréquente les clubs Saint-Bernard, Saint-Éloi, celui de la Révolution, travaille comme blanchisseuse. Elle espère un monde meilleur malgré les souffrances du siège. « Entre la faim, la colère et l’espoir, je commence à comprendre que, même dans cette ville dure et impitoyable, les Parisiens savent résister ensemble. »
Espérer un monde meilleur
Nous revivons ces scènes. Et puis le 18 mars, des femmes qui se parlent, s’estiment, s’activent dans les luttes. Joséphine évoque les grandes réformes initiées par la Commune. Elle est vivandière au 135e bataillon des Enfants perdus, celui d’Eudes. Elle est arrêtée le 23 mai en pleine Semaine sanglante, échappe de peu à la mort. Son procès se déroule le 4 septembre 1871, la reprise des débats est très intéressante. Dans un premier temps, condamnée à mort, elle verra sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Avec Léontine Suétens, Eulalie Papavoine, Louise Michel, elle attend à Auberive, son départ pour Toulon. Le 1er avril 1872, elle embarque sur L’Entreprenante, en direction de la Guyane. Elle arrive à Cayenne les 7- 8 mai 1872, porte le matricule n°258. Francis Brunet nous relate la vie au bagne de ces femmes, les conditions de vie sorCULTURE
31
LECTURES
dides, moins connues que celles de Nouvelle-Calédonie. Elle tente de s’évader et la fin de sa vie reste assez floue. L’auteur fait des choix, c’est son droit dans un roman. Sur une photo prise par Appert, on voit une belle femme, tête haute, le regard droit, fière de ses idées dans une tenue simple. Ne l’oublions pas, Joséphine Marchais, victime de la répression, des tribunaux, de la prison et des mauvais traitements de la vie.
FRANCIS PIAN
Francis Brunet, Joséphine Marchais … De Blois à l’île du Diable, Éd. Francis Brunet, 2025
LA SEMAINE DE MAI
Cet ouvrage résulte d’une enquête minutieuse de Camille Pelletan sur les événements survenus lors de la Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Publiée dans un premier temps sous forme de feuilleton en 1880 dans le but de soutenir la demande d’amnistie des communards, elle sera éditée en 1889.
Journaliste, il a recueilli d’une part, des témoignages de ceux qui vécurent cette période, bien souvent des opposants à la Commune, d’autre part fait l’analyse de nombreux articles parus dans la presse en prenant soin d’écarter ceux qui n’étaient pas vérifiables.
L’auteur rapporte ainsi ce que furent la violence et l’horreur de cette répression :
les massacres perpétrés par l’armée gouvernementale marquée à jamais par cette tache indélébile ; la cruauté et la lâcheté de la foule bourgeoise parisienne, ses délations honteuses pour s’approprier soit un logement convoité ou éliminer un concurrent.
Ce livre vaut aussi sa lecture pour la préface de Michèle Audin : ses précieuses notes, ses corrections, mais aussi par les questions qu’elle soulève à propos du manque de publications sur cette Semaine sanglante, que ce soit dans la littérature ou même dans notre association.
Et puis remercions les éditions Libertalia d’avoir réédité ce document, cent trente-trois ans après sa première publication.
JEAN-LOUIS GUGLIELMI
Camille Pelletan, La semaine de mai, Libertalia, 2022