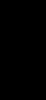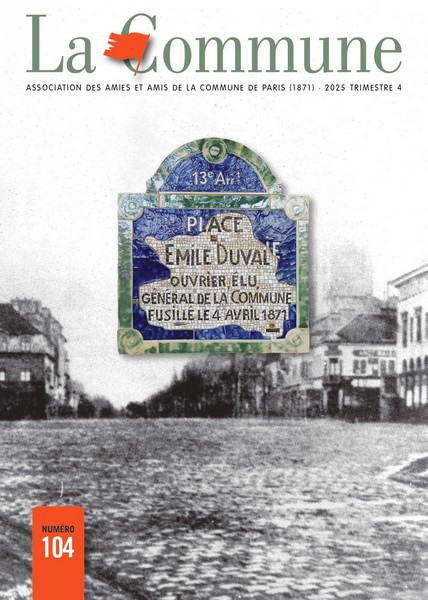17 janvier 1865, au 12, rue de Passy, Pierre-Joseph Proudhon est mourant.

Parmi ses amis, Courbet, qui est terriblement affecté par la nouvelle de la mort de son ami et « pays ». Il décide immédiatement de peindre un portrait de Proudhon (qui avait toujours refusé de son vivant de poser pour lui). C’est aussi un acte militant car de longue date Courbet sympathise avec les théories sociales de son ami. Il contacte Castagnary, un journaliste socialisant pour qu’il lui fournisse des documents, des photographies de Proudhon, de ses enfants (décédés). Puis il se met à l’œuvre dans son atelier du 32 rue Hautefeuille, cette ancienne chapelle, lotie de longue date.
Le tableau, intitulé Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants en 1853, a été souvent analysé : clairement Proudhon y est représenté en blouse d’artisan, à la manière d’un homme du peuple, un habit qu’effectivement il appréciait. Il semble ne pas prendre de pose. La présence des deux filles, dont l’une joue et l’autre apprend ses lettres, humanise le philosophe, mais surtout permet une allégorie de l’enfance idéale (l’instruction et le jeu).
Courbet n’avait pas eu connaissance du livre posthume où Proudhon avait écrit :
Peindre les hommes dans la sincérité de leur nature et de leurs habitudes, dans leurs travaux, dans l’accomplissement de leurs fonctions civiques et domestiques, avec leur physionomie actuelle, surtout sans pose [...] comme but d’éducation générale et à titre d’avertissement esthétique : tel me paraît être, à moi, le vrai point de départ de l’art moderne.
Le tableau reflète-t-il ce sentiment de l’art de Proudhon ? Certes le réalisme est là, mais la pose du penseur situe bien davantage l’œuvre dans une filiation esthétique qui part au moins de Raphaël.
Quelques semaines plus tard, le jeune Zola écrit un violent pamphlet, Mes Haines, contre le livre de Proudhon y voyant la « négation de l’art », mais faisant de Courbet d’abord un très grand peintre de « la famille des faiseurs de chair ». Et il est bien vrai que quelques semaines après avoir achevé son portrait de Proudhon, Courbet rencontre une jeune irlandaise, Johanna Hiffernan, probable modèle de L’Origine du monde !
Mais tous plaident pour la liberté de l’art :
on devient peintre en laissant à chacun l’entière direction de son individualité, la pleine liberté de son expression propre,
écrit Courbet en ouvrant un atelier pour jeunes peintres. Quelques années plus tard, le débat rebondira, fructueux, pendant la Commune.

Ce 3 mai 1865, au petit matin, c’est la ruche dans des petits bureaux du 3 place de la Sorbonne :
c’est que l’on s’affaire au lancement du premier numéro de Candide,
un nouveau bihebdomadaire dont l’éditorial annonce :
Candide ne veut pas être un journal futile. Ce genre est peu de son goût. Il désire encore moins être un journal ennuyeux. La concurrence l’écraserait. Instruire et plaire c’est son vœu. C’est beaucoup d’ambition sans doute. Tout le monde ne sait pas mêler l’utile à l’agréable.
L’auteur de l’édito est anonyme, et pour cause, c’est Blanqui ! Enfermé depuis quatre ans à Sainte-Pélagie, il bénéficie d’un mieux depuis février, installé dans une chambre gardée de l’hôpital Necker. Il vient d’avoir 60 ans et a alors le plaisir de recevoir toute une foule de jeunes étudiants qui veulent rencontrer le célèbre révolutionnaire. Parmi les visiteurs les plus assidus, Gustave Tridon, son principal disciple, Eugène Protot et Charles Longuet. On complote l’évasion de Blanqui, qui aura lieu en août, mais surtout la préparation d’un journal destiné en premier lieu à la jeunesse des écoles. Ce sera Candide. On décide de porter la lutte sur le terrain philosophique, pour éviter les foudres de la censure, sans doute, mais aussi parce que, pour Blanqui, la lutte anticléricale et pour l’athéisme doit être au cœur du combat républicain. Sous le pseudonyme de Suzamel (de Suzanne-Amélie, les prénoms de sa femme, une peintre trop méconnue), Blanqui y écrit de longs articles érudits sur l’Église, la religion et leur nocivité. Il y dénonce violemment les monothéismes israélites ou chrétiens.
Certains lui reprochent cette primauté donnée à la question religieuse au détriment de l’économie. Mais le journal a un succès considérable, il tire à plus de 10 000 exemplaires (plus que Le Temps). Il est lu, discuté dans les cafés du quartier latin. Il publie en feuilleton un futur chef d’œuvre de la littérature, La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel en Flandres et ailleurs de Charles De Coster. Sa radicalité lui vaut de rapides ennuis. Le 27 mai paraît le huitième et dernier numéro, suite auquel le journal est supprimé par la censure avec distributions de prison et d’amendes… pour délit d’outrages à un culte officiel.
Le Candide n’était pas le seul journal du quartier. Charles Longuet et Rogeard avaient fondé quelques mois avant La Rive gauche. Cette ébullition des étudiants parisiens allait encore se manifester quelques mois après à Liège lors d’un grand congrès international d’étudiants. Les étudiants français, comme Jaclard ou Lafargue, y multiplient les professions de foi socialistes ou matérialistes ! Et on ne manqua pas d’aller à Bruxelles saluer le « Vieux ». Le « parti » blanquiste allait se constituer. Blanqui allait compter bientôt 2 000 soutiens en 1869-1870, qui ne manqueraient pas à la Commune !

Il paraît que la grève est devenue légale depuis la loi du 25 mai 1864 !
Et la situation se tend à Saint-Etienne, en ce mois de septembre 1865. Un peu comme à Lyon, il y a une fabrique dans la ville. On y produit des rubans et velours de grande renommée. Toute la ville vit au rythme de ce travail. Joannès Caton, déporté en Nouvelle-Calédonie, se souvient :
Je me sens de nouveau bercé par le bruit accoutumé et monotone des métiers tissant le velours et du rouet préparant les canettes. J’entends le clairon et les tambours faisant école sous les murs du cimetière de Valbenoite, et mes souvenirs, à cette évocation, arrivent en foule. O pataire, crie l’acheteur de vieux (…) Et c’est le son des cloches des usines voisines (…) déversant leur peuple dans la rue, tous s’éparpillant pour aller à leur repas… Et le bruit des rouets… des métiers revient… me berce… et je m’endors sur la montagne, sous les hirondelles, entre les rochers recouverts de lichens et de mousses.
Le découpage social est complexe. La majeure partie de la production est assurée encore par des petits fabricants, mais de plus en plus dépendants des négociants. Et de grandes maisons et usines apparaissent comme celle des frères Giron. Il y a alors des maîtres et compagnons veloutiers, des « contremaîtres » dans les usines, des ouvriers veloutiers, des ourdisseuses, des dévideuses. Pour toutes et tous la vie est dure, le travail long et pénible. Progressivement se forme un salariat moderne. Les rubaniers et veloutiers ont fondé une petite mutuelle. Au début de 1865, la revendication d’une hausse des tarifs pour mieux vivre est avancée ; en juin, un comité de onze membres est créé. En août, Giron reçoit une délégation de « contremaîtres » demandant une hausse des « tarifs ». Il ne croit pas à une grève et dit à son frère qu’il peut dormir tranquille. Il se trompe lourdement ! En septembre plusieurs centaines de veloutiers se réunissent et votent la grève. Celle-ci va connaître un grand développement et des formes d’organisation inédites.
Un comité central de grève est créé. Il se réunit chez son trésorier, Thomas, 21 Place Chavanelle. Il divise la ville en quatre sections, chacune dirigée par un comité de quinze à vingt membres. La grève est très forte. Elle se déplace d’usine en usine, d’atelier en atelier. On organise le bris des vitres des jaunes. « Jamais une association ne fut plus complète et plus parfaite », écrira le procureur. En novembre, la répression s’abat sur la ville. Les « meneurs » sont condamnés à plusieurs mois de prison. La grève avait été tolérée mais pas l’organisation ! Mais le mouvement n’est pas mort, les ouvriers se replient sur la mutuelle qui connaît un vif essor. Et nombre des jeunes grévistes se retrouveront dans la Commune de Saint-Etienne, le 25 mars 1871.
JEAN-LOUIS ROBERT
Voir l'année 1862, 1863, 1864, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870