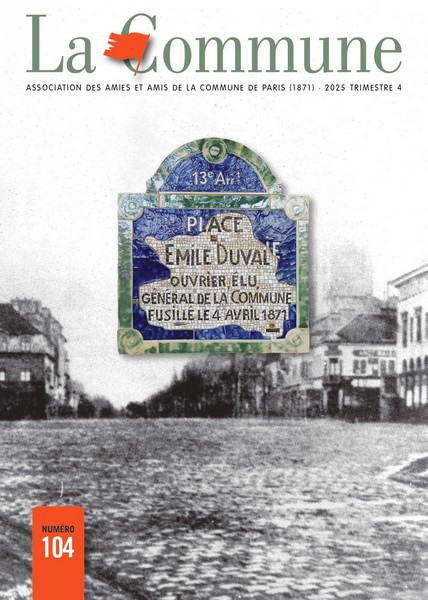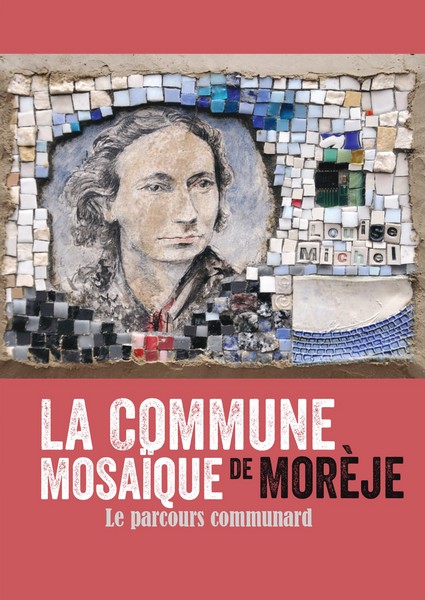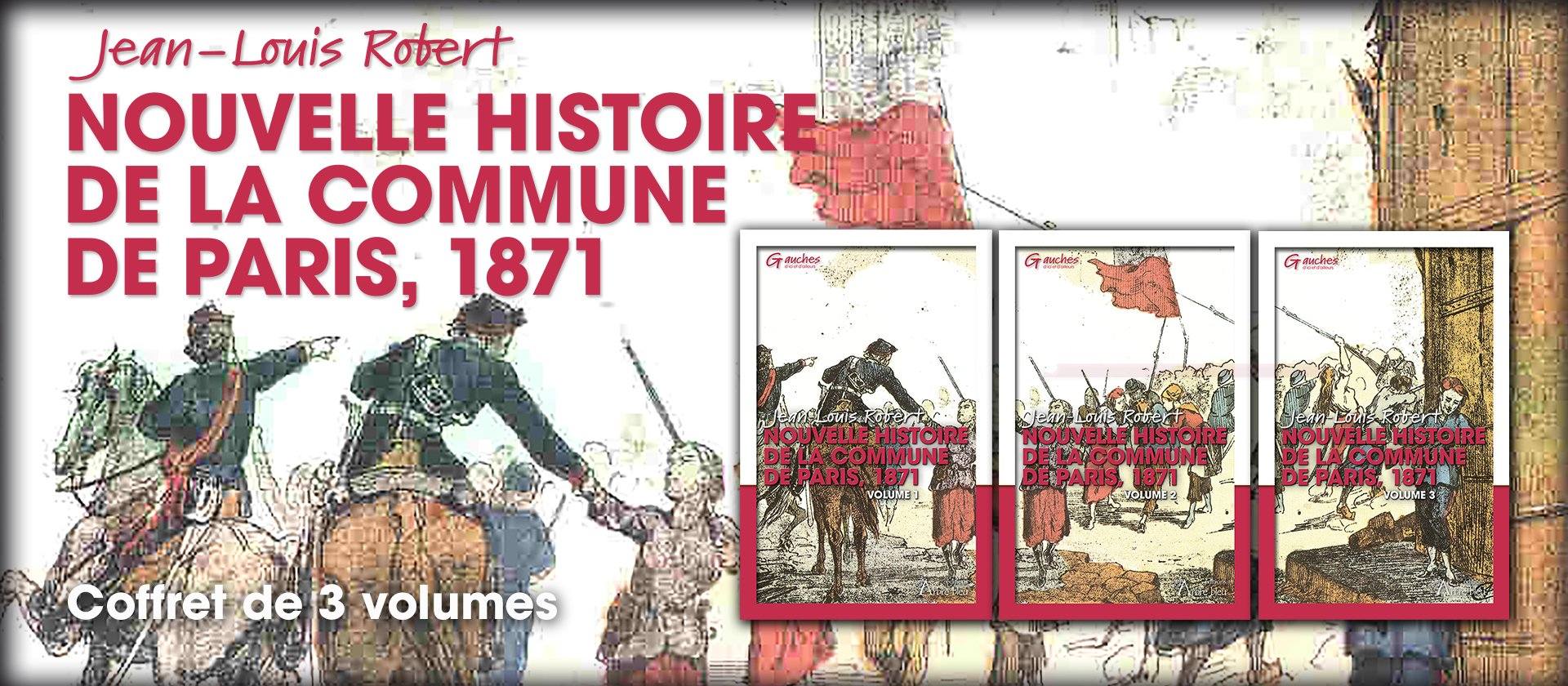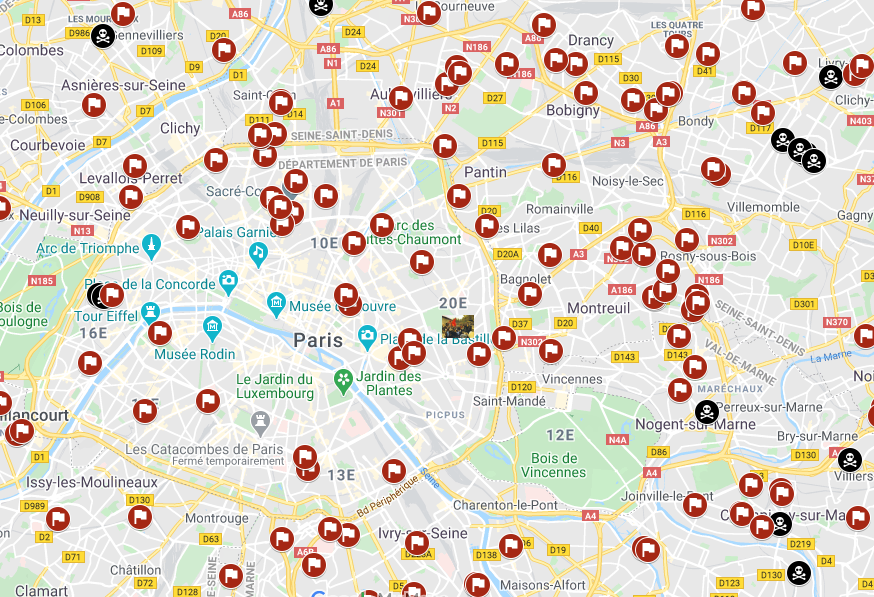Un lien invisible circulerait-il entre l’aristocrate Élisabeth Dmitrieff, accourue en 1871 à Paris pour se jeter dans la Commune, le collectif du « samizdat des femmes de Leningrad » au milieu des années 1970, et l’avocate Nadezhda Kutepova, défenseure infatigable, au XXIe siècle, des victimes du nucléaire ? À travers leurs parcours d’exil, de résistance et de combats, peut-on dessiner une permanence, chez elles, de conjugaison entre révolution et droits humains ? Ces questions étaient posées le mardi 8 avril 2025 à l’UXIL, « Universités en exil », sur le Campus Condorcet, lieu d’accueil des scientifiques et artistes réfugié.e.s.

Les femmes russes, dans leur lutte depuis le XIXe siècle, plus encore sans doute que les hommes, n’ont cessé de conjuguer droits politiques, sociaux et privés.
La très jeune Élisabeth Loukinitchna Koucheleva (19 ans), dite Dmitrieff, quitte en 1870 la Russie tsariste pour Genève, portée par un livre, Que faire ? de Nikolaï Tchernychevski. Il y propose un programme révolutionnaire où se mêlent renversements privés et publics : le triangle amoureux (une femme deux hommes) et un modèle d’entreprise autogestionnaire menée par les femmes seront les piliers de la nouvelle société. L’Union des femmes, qu’elle imagine avec Nathalie Le Mel, au lendemain du 18 mars 1871, reconnaît l’union libre, impose l’égalité des salaires et propose aux ouvrières de s’emparer des ateliers abandonnés.
Cinquante ans plus tard, Alexandra Kollontaï, bolchévique et première femme à devenir ministre en URSS, publie à son tour son « roman fondateur ». Dans Les amours des abeilles travailleuses, publié en 1923, cette fille de général dispose, elle aussi, qu’il ne peut y avoir de transformation radicale sans repenser l’amour et la sexualité. La « monogamie successive » est érigée en préambule aux mesures sociales et familiales à prendre : aide à la petite enfance, facilitation du divorce entre époux consentants, union libre légalisée, notion d’enfant illégitime abolie, accès a la santé ouvert à parité aux deux sexes. Autant d’échos à l’œuvre des communardes.
Mais les revendications des dissidentes s’infléchissent avec l’avènement de Staline et de ses successeurs. Alors que selon les autorités soviétiques l’émancipation des femmes n’est plus à conquérir, le « mouvement des femmes de Leningrad », pionnier de la contestation dans les années 1970, dénonce cette autosatisfaction perpétuée par Khroutchev et Brejnev. Artistes, écrivaines, elles s’insurgent dans leur publication Femme et Russie contre l’abandon des hopitaux et des maternités, les violences faites aux femmes, la double charge de travail des salariées. Harcelées par les autorités, arrêtées, emprisonnées, exilées, leur résistance s’infléchit vers le spirituel, en témoigne leur nouvelle revue Maria.
Les chercheuses, artistes et activistes russes, en rupture avec le despotisme à l’œuvre dans la Russie du XXIe siècle, sont sur tous les fronts : antinucléaires, pacifistes mais surtout avides de démocratie réelle. Comme un retour à l’esprit de la Commune.
SYLVIE BRAIBANT