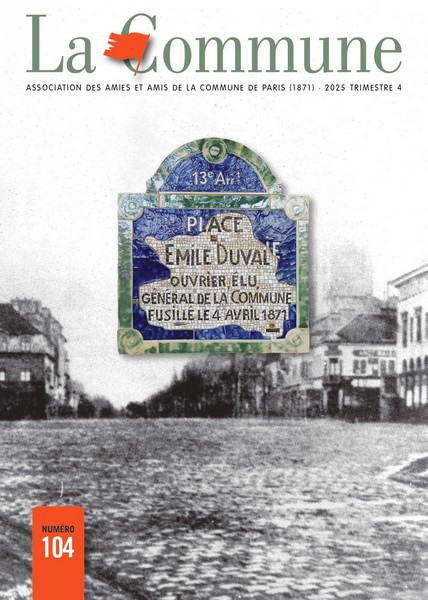Le 3 septembre 1870 fut le dernier samedi du Second Empire.
À la mairie du XVIIIe, place de l’Abbaye — aujourd’hui place des Abbesses —, comme ailleurs à Paris, un officier d’état civil nommé célébrait les mariages.

Un adjoint au maire, nommé Louis Achille Lorrain, maria quelques couples le matin. Puis, à trois heures du soir, Marie David, une institutrice, épousa l’homme de sa vie, avec qui elle vivait 4, rue Houdon. L’acte de mariage nous apprend qu’elle avait commencé par porter le nom de sa mère, Grangeret, puis celui de son père, David, quand celui-ci l’avait reconnue. Elle était (un peu) connue sous le nom de Marie David, on l’appellerait maintenant Mme La Cécilia.
La veille, le 2 septembre, Napoléon III capitulait après ce qu’il est convenu d’appeler le « désastre de Sedan ». Le lendemain, le 4 septembre, la République fut proclamée — de sorte que c’est un officier républicain, Georges Benjamin Clemenceau, qui célébra, le mardi 6, le premier mariage républicain place de l’Abbaye. Les La Cécilia se contentèrent de Lorrain.
Mariée par un inconnu, Marie David, que l’on appelait aussi Maria, n’était pas complètement inconnue. Jeune femme (elle est née en 1839) militante, élève et amie de Louise Michel, d’André Léo, institutrice, son nom était apparu dans l’hebdomadaire Les Droits des femmes, elle était secrétaire de la Société de la revendication des Droits des femmes, qui avait son siège chez elle (et dans laquelle nous trouvons André Léo, Noémi Reclus, Augustin et Caroline Verdure), future professeur de comptabilité dans l’école pour jeunes filles préparée par cette société (dont le professeur de géographie aurait été Élisée Reclus) et annihilée par la guerre avant même son ouverture en octobre 1870. Elle n’épousait pas non plus un parfait inconnu : Napoléon La Cécilia, son époux, était un mathématicien, linguiste et militaire distingué, décrit modestement comme un « homme de lettres » dans l’acte de mariage.
Il n’est pas exclu que quelques-uns de ses amis et amies aient assisté à son mariage. Ni André Léo, ni Louise Michel, ni Caroline Verdure ne furent témoins : seuls les hommes pouvaient jouer ce rôle.
Marie David était peut-être enceinte le jour de son mariage, toujours est-il que la petite Marguerite Elisabeth Marie Pauline La Cécilia naquit sept mois plus tard… et choisit admirablement son heure : le 28 mars à quatre heures du soir, au moment précis où la Commune était proclamée place de l’Hôtel-de-Ville. Ceci explique que l’on entende peu parler de Marie David pendant la Commune. Elle est qualifiée de « sans profession » sur l’acte de naissance ; Napoléon La Cécilia, lui, est « colonel commandant les francs tireurs de Paris ». Il avait notamment, peu après son mariage, participé glorieusement à la bataille de Châteaudun. Et il défend Paris.
Elle peut-être aussi. Dans Le Gaulois, le 30 mai :
« La femme du général La Cécilia a été tuée derrière une barricade, non pas qu’elle défendait, mais à laquelle elle apportait des pavés. Son corps a été retrouvé, percé de coups de baïonnettes. Elle était mère d’un enfant de sept mois, qui n’a pas été retrouvé. »

Craignant le chantage contre son mari que pourrait constituer son arrestation par les troupes versaillaises, elle se cache pendant la Semaine sanglante. Elle n’a pas tort. Voici un article que citent Pain et Tabaraud dans L’Intransigeant du 4 septembre 1880 — un véritable morceau d’anthologie :
« Le musée Orfila va s’enrichir d’un objet aussi curieux au point de vue scientifique qu’au point de vue qu’il éveille : il s’agit de la main de la générale La Cécilia, coupée après son exécution et conservée par le docteur Bayle. Cette main est d’une patricienne, petite, élégante, fine ; ses attaches au poignet sont délicates, ses ongles bien plantés. Seulement, un indice trahit la barricadière : la main aristocratique est sale, les ongles ne sont pas taillés et portent le deuil des soins de toilette. L’examen de la conformation de cette mignonne main décèle en même temps l’énergie du caractère de la femme :
le pouce est long, signe d’une volonté voisine de l’entêtement ; l’index atteint la hauteur du médium, ce qui dénote le besoin du commandement ; enfin le mont de Mars, dans la paume de la main, est d’une proéminence particulière.
On sait comment cette jeune et élégante femme fut passée par les armes. Elle se trouvait, le jour de l’entrée de l’armée, derrière la barricade élevée au coin de la rue de la Paix.
Cette barricade fut cernée et tous ses défenseurs faits prisonniers. Étonnés de voir, au milieu des horribles types de la Commune, une jeune femme couverte de soie et de dentelles, les officiers la remarquèrent plus particulièrement et l’un d’eux la reconnut. Il avait été le compagnon d’armes de La Cécilia, officier de l’armée de la Loire.
Pendant ce temps, on avait rangé le long de la barricade les insurgés pris les armes à la main, et l’exécution commençait ; les officiers, apprenant le nom de la jeune femme, voulurent la sauver. Ils donnèrent l’ordre de la conduire au poste voisin.
Mais, folle, égarée, la malheureuse repoussa violemment les soldats ; elle se jeta à terre, se roula dans la boue en hurlant et criant aux officiers atterrés :
– Lâches, lâches qui tuez les femmes, tuez moi donc !
On essaya vainement de la faire se relever ; elle résista comme une furie. Enfin un soldat, fatigué de ses insultes, lui tira un coup de fusil : elle tomba foudroyée.
Son cadavre fut transporté à Clamart, et c’est là que M. le docteur Bayle eut l’autorisation d’emporter sa main pour y tenter ses expériences. »
Il n’a sans doute pas lu cet article, paru plus tardivement, mais son mari a cru à l’exécution de Marie.
Elle a du mal à trouver un ami qui l’héberge, elle passe beaucoup de temps sous la pluie avec son bébé de deux mois, qui meurt dans l’hôtel de la rue Saint-André-des-Arts où elle a fini par trouver refuge. Le décès est déclaré sous un faux nom (peut-être Marie Marguerite Lecointre) et la petite enterrée. Marie parvient ensuite à gagner la Belgique où elle espère que son mari, avec qui elle a pu communiquer, la rejoindra.
Et il la rejoint. C’est sous le nom de Lacombe qu’elle et son mari arrivent chez Victor Hugo à Vianden (Luxembourg) le 20 juillet – ce qui est cohérent avec une information donnée par Le Radical le 14 juin 1872 (il est resté caché cinquante-deux jours chez une couturière). Ils gagnent ensuite Londres. Quand exactement ?
Ils y ont un fils, le 27 juillet 1872. Je ne sais pas si elle trouve un emploi – son mari enseigne les langues asiatiques. Elle correspond avec ses amies en France. Voici un extrait d’une lettre à Euphémie Garcin, une amie du temps des Droits des femmes, que Le Figaro cite, le 21 novembre 1871, après L’Avenir (d’Auch) :
« Ils parlent des otages. Oui, le massacre des otages est une chose épouvantable ; mais, d’abord, l’archevêque aurait pu être échangé, si M. Thiers l’avait voulu… Et puis, en toute justice, il ne faut pas oublier qu’on les fusilla seulement deux ou trois jours après que des milliers et des milliers de fédérés, prisonniers et désarmés, avaient teint de leur sang le pavé des rues.
Comme vous avez pu vous en convaincre, seulement par la lecture des journaux infâmes qui prospéraient sous l’Empire, on vit alors, à Paris, des hommes altérés de sang. »
Je ne résiste pas au plaisir de citer un mouchard, qui écrit de Londres, le 8 octobre 1873, dans un rapport sur La Cécilia :
« Relativement à sa femme, elle n’est ni jeune, ni belle, mais c’est une bonne personne, sans prétention, qui tient parfaitement sa maison. »
Plus tard, ils partent pour l’Égypte, dont le climat est meilleur pour lui, ce qui ne l’empêche pas d’y mourir de la tuberculose.
Marie est veuve en 1878 et regagne la France avec son fils. Si démunie qu’on la retrouve dans une lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo, le 10 décembre :
« Je te fais souvenir, aussi, que tu as cent francs destinés à venir en aide à Mme La Cécilia. »
Une conférence publique est organisée à son profit le 5 mars 1879, à laquelle participent Carjat, Callet, Lockroy, Clemenceau et d’autres.
Au début des années 1890, elle dirige une institution pour jeunes filles délinquantes du département de la Seine, installée à Yzeure (Allier) — travail difficile et ingrat. Elle y passe quatre ans. En 1893, elle est de retour à Paris et elle habite 24 rue Pavée, dans le Marais. Elle continue à enseigner.
La dernière trace que je connais d’elle est une lettre qu’elle a écrite à André Léo en juin 1898 et qui est conservée dans les archives Descaves à Amsterdam :
« Chère amie
Voilà ce que j’ai fait cette semaine :
47 inspections à Charonne
2 après-midi consacrées à la jeune Henriette Chassaing qui a passé son brevet
Une après-midi au salon de peinture qui n’a pu être qu’aujourd’hui samedi jour où j’ai eu les cartes. J’étais loin de vous attendre ce jour. Ajoutez à cela un gros rhume de cerveau qui m’a laissé une forte toux de poitrine et vous comprendrez que [illisible] dimanche je ne puisse aller au Jardin d’acclimatation. Je vais me purger et faire mes écritures. Si vous voulez nous irons dimanche prochain. En ce cas écrivez-moi une petite carte ou autrement. Si je le pense j’irai voir les amis Garcin que je n’ai pas vus depuis bientôt deux ans.Votre toute dévouée qui vous embrasse
M. La Cécilia ».
Une femme de cinquante-huit ans, active professionnellement et socialement… Cela vaut mieux pour terminer qu’un acte de décès
— et je ne sais de toute façon ni où ni quand elle est morte.
MICHÈLE AUDIN
Sources
J’ai utilisé le dossier La Cécilia (BA 1005) aux Archives de la Préfecture de police. C’est dans ce dossier que j’ai trouvé l’enveloppe portant l’adresse de Marie. Comment elle se trouve là ? Sans doute à la suite d’une perquisition en juin 1871...
Certaines des sources de cet article m’ont été données par Jean-Pierre Bonnet, que je remercie.
Blog de Michèle Audin : https://macommunedeparis.com/
Livres et articles utilisés :
- Primi (Alice), « Être fille de son siècle » : l’engagement politique des femmes dans l’espace public en France et en Allemagne de 1848 à 1870, Thèse, Université de Paris 8 (2006) ;
- Pain (Olivier) et Tabaraud (Charles), Les évadés de la Commune, série d’articles dans L’Intransigeant (1880) ;
- Hugo (Victor), Choses vues, Quarto Gallimard (2002).